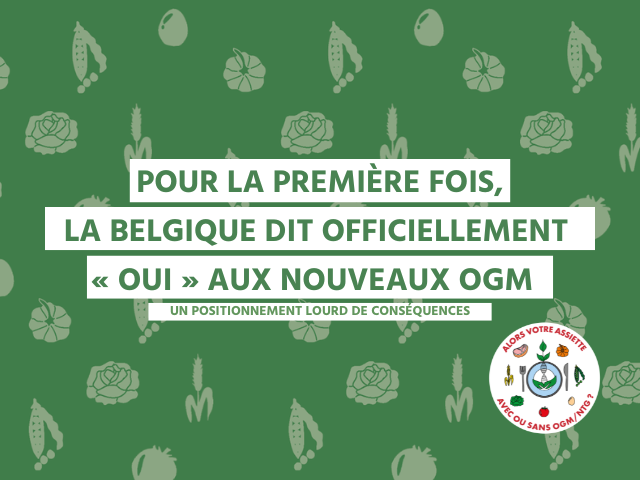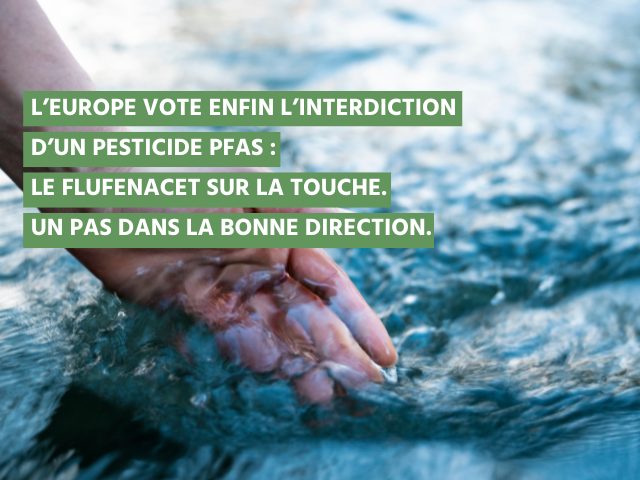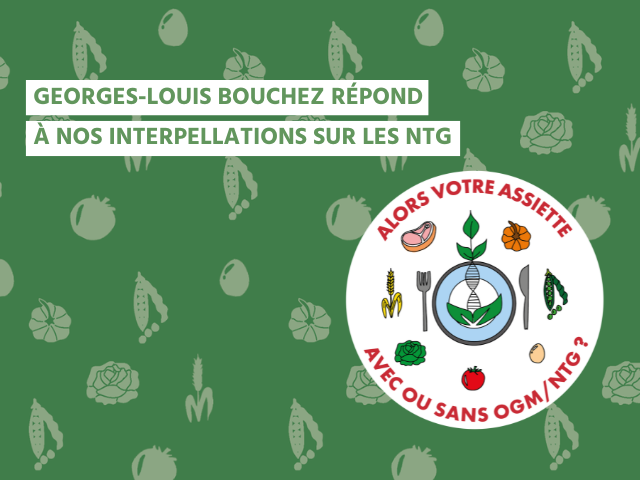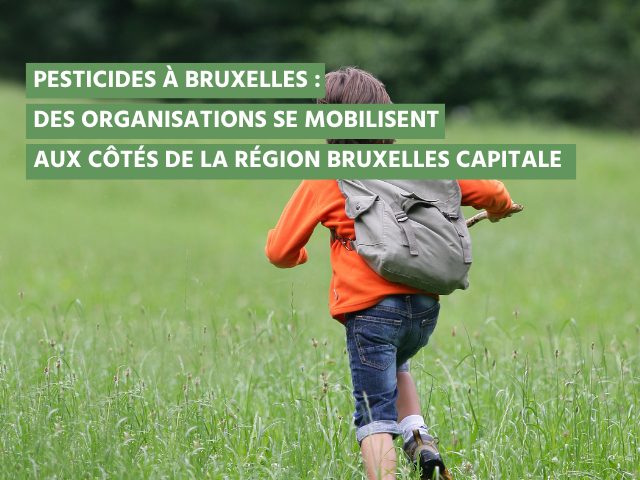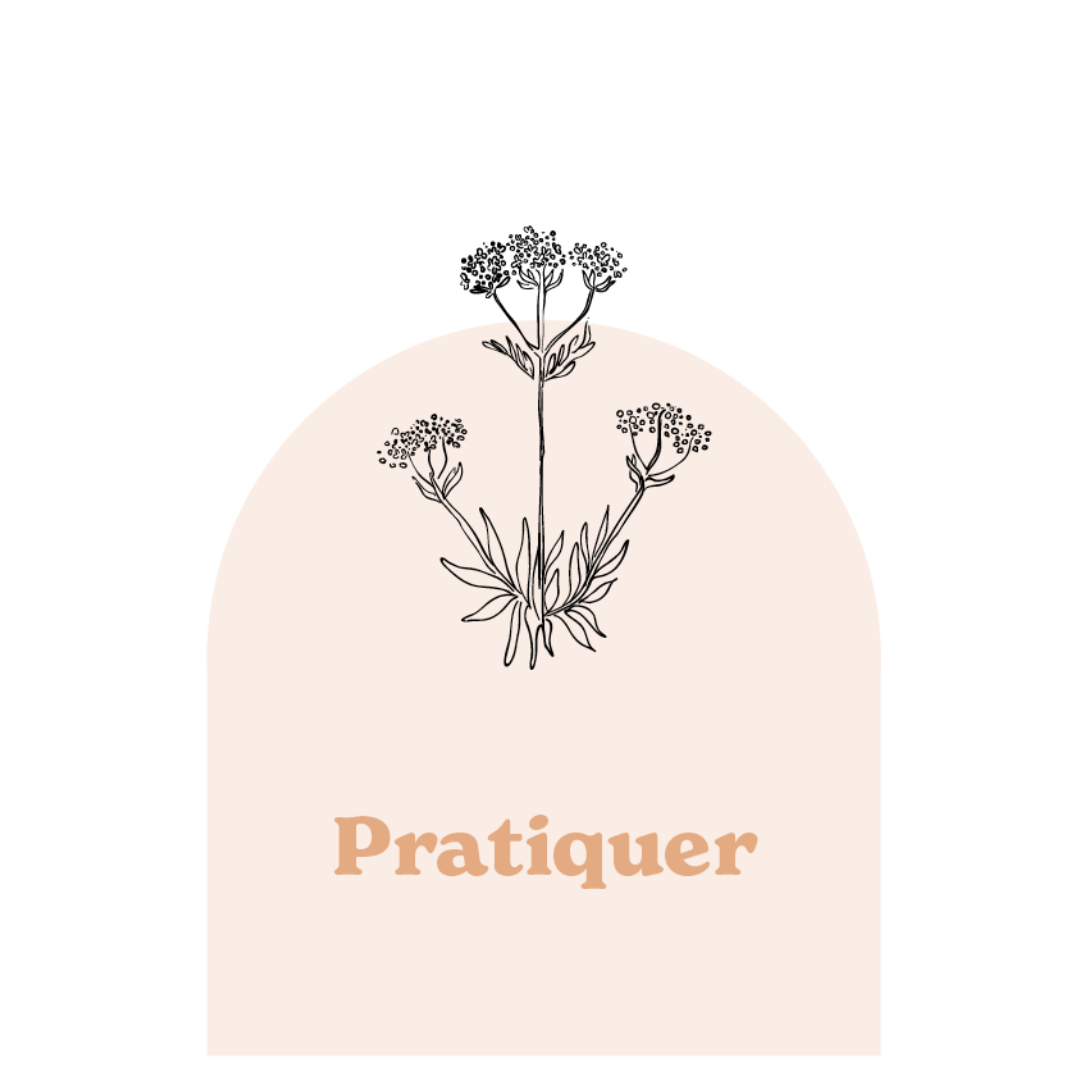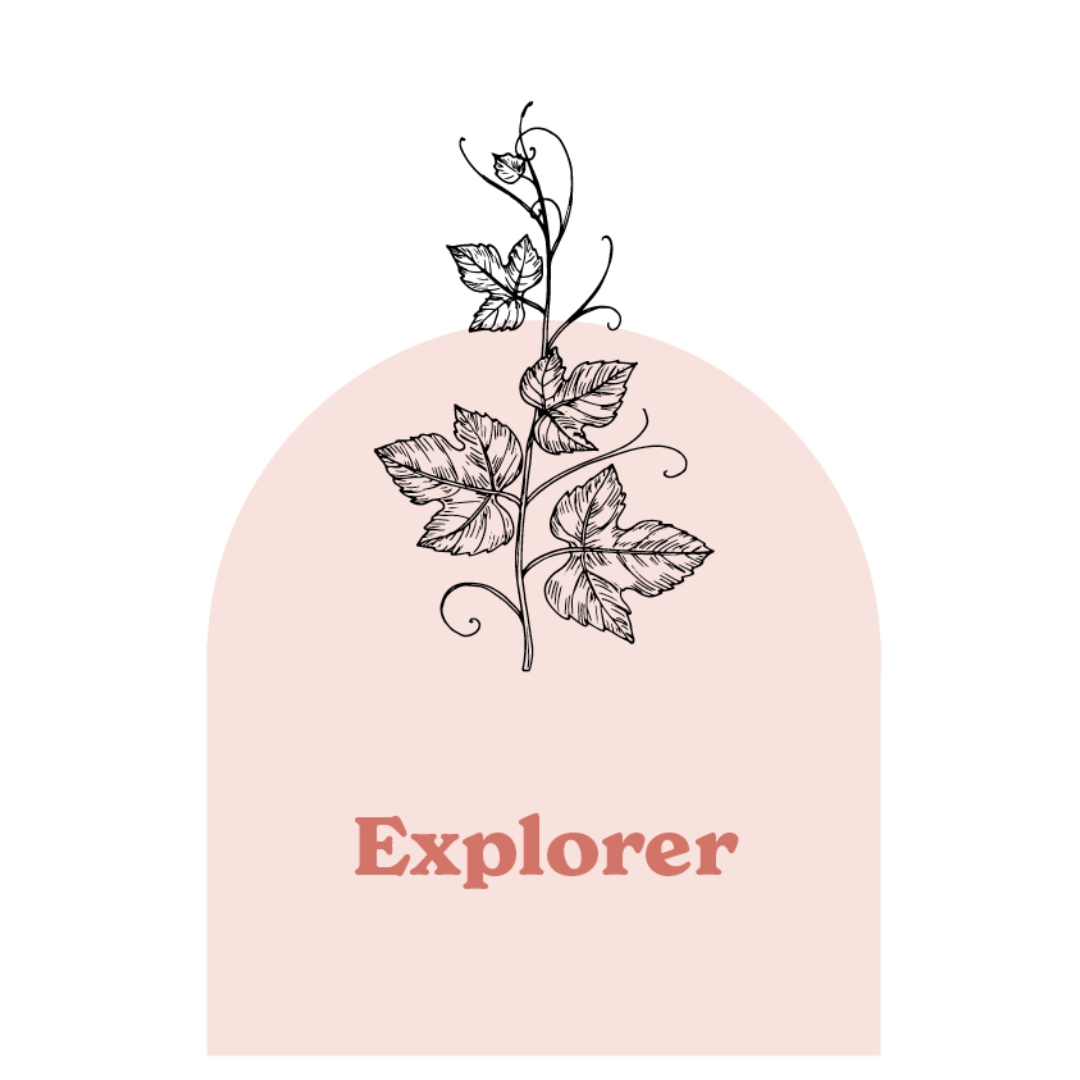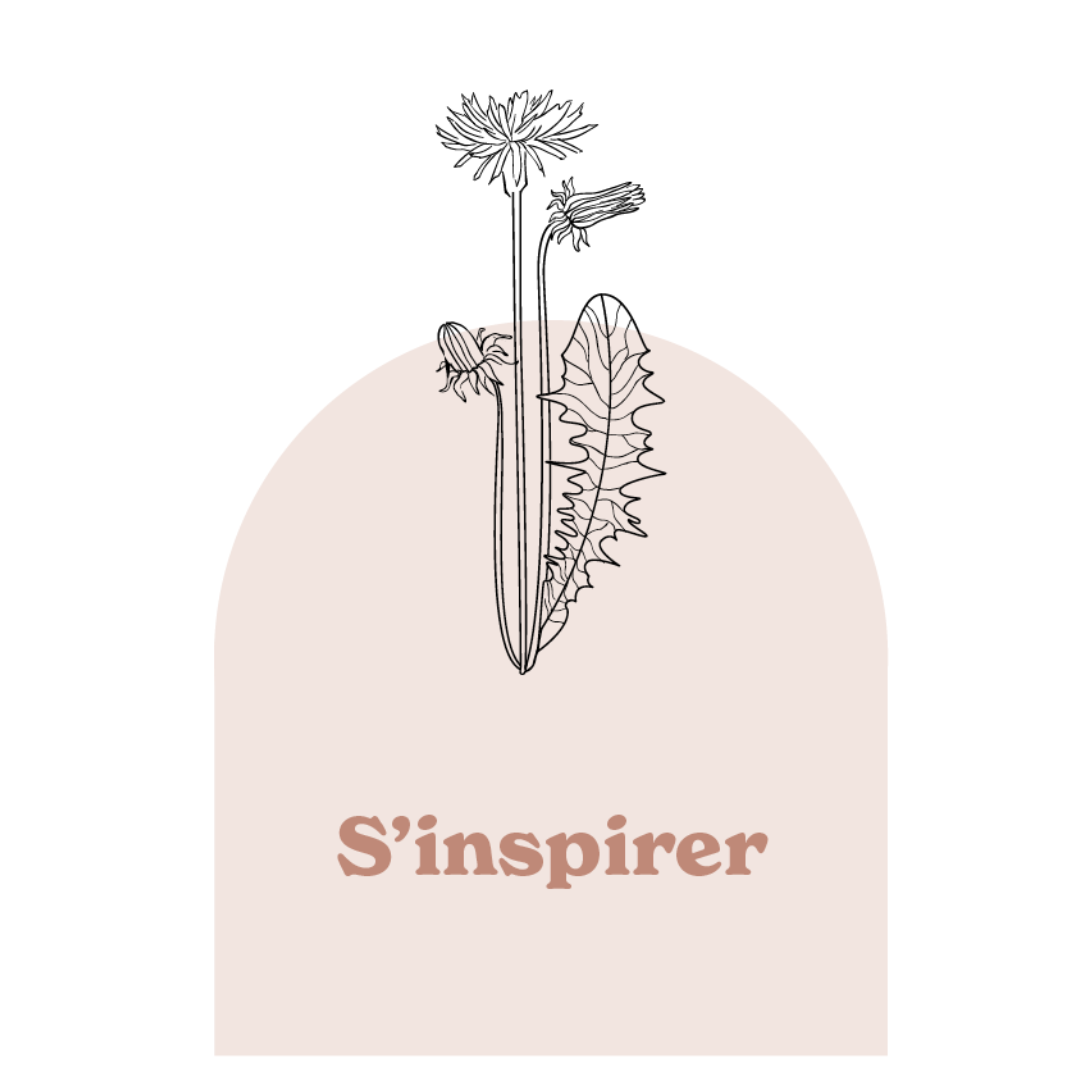Augmentation alarmante de la présence du TFA dans les vins européens
De nouvelles données révélant une augmentation dramatique des niveaux de l’acide trifluoroacétique (TFA) dans l’environnement ont été publiées aujourd’hui par Nature & Progrès et le réseau PAN Europe dans son rapport « Message from the Bottle – The Rapid Rise of TFA Contamination Across the EU ». [1]
Le TFA est le produit final non dégradable de la décomposition d’autres composés PFAS, tels que ceux utilisés dans les technologies de réfrigération ou comme substances actives dans les pesticides. Après avoir analysé la présence de TFA dans les eaux, le réseau européen PAN Europe s’est penché sur le vin, un produit agricole, connu pour être gourmand en pesticides.
« Nous avons analysé 10 vins anciens et 39 vins récents provenant de 10 pays européens. Le TFA a été détecté dans tous les vins récents, avec une concentration environ 100 fois plus élevée que les niveaux moyens – déjà élevés – mesurés dans nos études de l’année passée sur les eaux de surface et les eaux potables. En revanche, le TFA n’a pas été détecté dans les vieux vins récoltés avant 1988 … » annonce Virginie Pissoort, responsable du dossier « Pesticides » chez Nature & Progrès
Des analyses parallèles des pesticides sur les mêmes échantillons ont révélé la présence de résidus de 8 pesticides et de métabolites de pesticides dans 94 % des vins produits de manière conventionnelle. Au total, 18 pesticides étaient détectables dans toutes les bouteilles, dont deux fongicides PFAS bien connus en Belgique, le fluopyram et le fluopicolide. La concentration médiane de TFA dans les vins analysés était de 110 µg/L avec des pics allant jusqu’à 320 µg/L. Les vins situés dans la moitié supérieure de la fourchette de concentration de TFA (moyenne : 176 µg/l) présentaient, en moyenne, une charge en pesticides deux fois supérieure à celle des vins situés dans la moitié inférieure (moyenne : 58 µg/l).
Pour Helmut Burtscher-Schaden, chimiste de l’environnement à GLOBAL 2000 et initiateur de cette étude :
« Ces résultats sont alarmants à deux égards. Le premier est la forte concentration détectée, qui indique une bioaccumulation massive de TFA dans les plantes : Il est probable que nous ingérions beaucoup plus de TFA par le biais de notre alimentation que ce que l’on pensait jusqu’à présent. Ce que notre étude révèle d’encore plus inquiétant, c’est la forte augmentation de la contamination depuis 2010. »
La confirmation de la forte augmentation des niveaux de TFA provient également d’une comparaison avec les données officielles de l’UE collectées par le laboratoire de référence de l’UE CVUA Stuttgart. Une étude officielle de 2017, réalisée pour le compte de la Commission européenne, reste à ce jour la seule enquête officielle sur le TFA dans les aliments. À l’époque, 27 vins européens présentaient une concentration médiane de 50 µg/l, avec une valeur maximale de 120 µg/l. En revanche, notre nouvelle enquête de 2025 fait état d’une médiane de 110 µg/l, avec des pics de 320 µg/l.
« Ces résultats doivent être prises au sérieux par les autorités, et ne pas rester des bouteilles jetées à la mer. Les substances qui libèrent du TFA dans l’environnement doivent être retirées du marché sans délai. Cela doit commencer par une interdiction immédiate de tous les pesticides PFAS – une source directe et facilement évitable de pollution par le TFA car des alternatives existent- ainsi qu’une interdiction des gaz F. » souligne Pour Virginie Pissoort de Nature & Progrès
Sa collègue du réseau européen, Salomé Roynel ajoute :
« À la mi-mai, les États membres de l’UE seront invités à voter sur la proposition de la Commission visant à interdire le flutolanil, un pesticide à base de PFAS qui émet des TFA. Nous espérons qu’ils comprendront qu’il s’agit d’un moment décisif pour l’avenir de notre eau, de notre alimentation et, en fin de compte, de notre santé, et qu’ils voteront en faveur de l’interdiction de ce pesticide ».
Contexte sur les pesticides PFAS et la pollution au TFA
Le Site Nature et Progrès revient sur la pollution aux pesticides PFAS et au TFA et sur les risques pour la santé et l’environnement de cette contamination sans précédent. En bref, on notera ceci :
Du point de vue des causes, en ce qui concerne la contamination des eaux souterraines, il faut noter qu’une étude de l’Agence allemande de l’environnement, a considéré que les pesticides PFAS utilisés en agriculture représentaient en milieu rural, une part annuelle potentielle de 76 %, suivis par les émissions de TFA provenant de la pluie (provenant principalement des gaz fluorés utilisés dans les systèmes de refroidissement) à hauteur de 17 %, et par les stations d’épuration des eaux usées et le fumier à hauteur de 3 % chacun.
D’un point de vue toxicologique, le TFA a longtemps été considéré comme largement inoffensif, en particulier par les fabricants de PFAS. Toutefois, une étude réalisée en 2021 sur le TFA à la demande des fabricants de pesticides dans le cadre du règlement REACH sur les produits chimiques a révélé de graves malformations chez les fœtus de lapins. Depuis lors, le TFA est soupçonné de présenter un risque pour la santé reproductive humaine et a fait l’objet d’une demande de classification, comme reprotoxique de catégorie 1B par l’Allemagne.
Notre étude qui a consisté à tester des vins d’Autriche, de Belgique (un vin de Flandre et un de Wallonie), de Croatie, de France, d’Allemagne, de Grèce, de Hongrie, d’Italie, du Luxembourg et d’Espagne, a été menée en collaboration avec les membres et les partenaires de PAN Europe : Autriche (GLOBAL 2000), Belgique (Nature & Progrès et Bond Beter Leefmilieu), Croatie (Earth Trek), France (Générations Futures), Allemagne (PAN Germany), Grèce (Ecocity), Hongrie (MTVSZ/Friends of the Earth Hungary), Luxembourg (Mouvement Écologique), Espagne (Ecologistas en Acción), et Suède (Naturskyddsföreningen).
[1] En français : « Message de la bouteille – Augmentation rapide de la contamination par le TFA dans l’UE ». Pour l’étude en version originale en anglais https://www.pan-europe.info/message-in-a-bottle