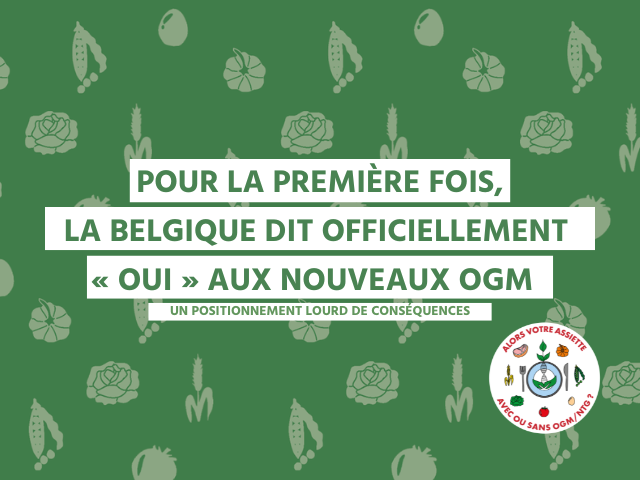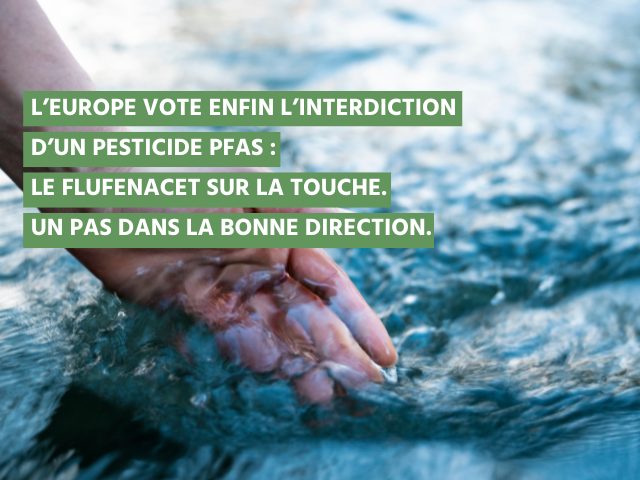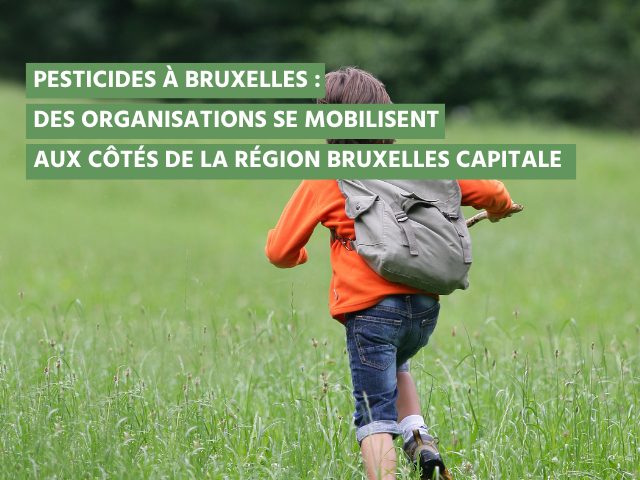Citoyen·nes, rejoignez les professionnel.le.s de la santé et scientifiques et faites entendre votre voix !

© Adobe Stock, tous droits réservés
Nous aurons l’occasion de la porter lors des auditions parlementaires prévues ces 24/06 et 8/07, pour que les citoyen.nes et en particulier, les enfants, les agricultrices et agriculteurs ainsi que les riverains, soient protégés des pesticides.
Rejoignez-nous et signez notre appel ci-dessous !
Nous ne pouvons accepter que la santé soit sacrifiée sur l’autel de la prospérité de l’industrie agro-alimentaire et chimique.
Nous, société civile, rejoignons l’appel lancé par les professionnel·les de la santé et les scientifiques pour interpeller la ministre wallonne de l’Agriculture, Mme Dalcq, ainsi que le gouvernement, afin de protéger celles et ceux qui sont en première ligne face aux pesticides : les enfants, les agricultrices et agriculteurs ainsi que les riverains, et in fine, nous toutes et tous.
Ce n’est pas un débat technique réservé aux spécialistes ou aux lobbies. Ce qui est en jeu, c’est notre droit fondamental à vivre dans un environnement sain.
Nous rejoignons l’appel des professionnels de la santé sur les points suivants[1] :
Tout d’abord, assimiler un pesticide à « une molécule trouvée dans la nature que l’on a modifiée un peu pour mieux cibler son action », comme l’affirme la ministre, est au mieux l’indice d’une sérieuse méconnaissance de ces produits (car la majorité des pesticides sont à ce jour des molécules de synthèse), au pire, l’indice de la volonté de nier la dangerosité pourtant avérée de certaines de ces molécules. Dans les deux cas, cela est hautement problématique, et incompatible avec le devoir d’exemplarité d’une ministre de l’Agriculture.
Mais encore, il est inexact de dire que « tous les paramètres de santé sont contrôlés par des toxicologues ». En effet, le système actuel comporte de nombreuses lacunes, notamment au niveau des essais qui se basent sur des modèles simplifiés ne pouvant rendre compte de la complexité des systèmes naturels. La preuve en est, qu’après quelques années d’utilisation en conditions réelles, des effets indésirables sont observés sur la santé et/ou sur l’environnement, aboutissant à un retrait des autorisations délivrées (l’exemple du retrait récent du Flufénacet est démonstratif). Ces interdictions ou retraits n’empêchant d’ailleurs pas leurs effets néfastes de perdurer. Il en va ainsi de dizaines de pesticides ou de leurs produits de dégradation, toxiques et rémanents dans l’environnement, comme le DDT et autres organochlorés interdits depuis des années voire des décennies, que l’on retrouve sous forme de résidus dans nos aliments, nos eaux souterraines et finalement comme contaminants dans notre sang. Demain ce sera le cas des dérivés des pesticides PFAS.
La ministre semble ignorer les tenants et aboutissants de la procédure d’autorisation des produits phytopharmaceutiques (les « pesticides »), ce qui est inquiétant.
(…) la partie la plus problématique de l’enjeu des pesticides concerne notre santé, celui-ci devrait – c’est le bon sens même – être discuté avec scientifiques et médecins, mais il semble que la ministre préfère en discuter avec les entreprises phytopharmaceutiques et les producteurs de semences tout en continuant d’ignorer, comme ses prédécesseurs, les effets délétères massifs des pesticides sur la santé et la biodiversité.
Pourtant les données scientifiques ne cessent de s’accumuler et de renforcer le faisceau de preuves. Paradoxalement, les résultats des études commanditées par la Région Wallonne elle-même ces dernières années restent ignorés, les experts scientifiques inaudibles et les recommandations émises non suivies d’effet. Pour preuve l’AGW sur l’emploi des pesticides qui n’a pas été révisé suite aux études menées par l’ISSeP, le CRA-W et l’ULiège.
Nous sommes toutes et tous contaminés par les pesticides, y compris pendant des périodes de vie de haute vulnérabilité à leur toxicité. Femmes enceintes, bébés, enfants, adolescents. Personne n’y échappe. Les études de biomonitoring montrent que dans notre pays, les pesticides sont d’ailleurs parmi les polluants les plus retrouvés chez les enfants.
En Belgique, plus de 5.000 tonnes de substances actives pesticides sont épandues chaque année. Une grande part des substances autorisées en Belgique sont cancérigènes, toxiques pour la reproduction, toxiques pour les organes, irritantes pour la peau. De nombreuses substances actives ont des effets de perturbation endocrinienne. Une trentaine sont des PFAS. Sans oublier toutes les autres substances ajoutées à la molécule active, les co-formulants, dont plusieurs sont des biocides (métaux lourds, arsenic, hydrocarbures…).
L’impact des pesticides sur le déclin de la biodiversité et sur la santé humaine est considérable. Ce ne sont pas des opinions. Ce sont des faits scientifiques.
Nous ne pouvons accepter que la santé soit la variable d’ajustement des systèmes alimentaires industriels. Nous ne pouvons accepter que la santé soit la grande oubliée des discussions et des décisions prises en matière d’agriculture. Aujourd’hui, les externalités négatives du complexe agro-industriel sont assumées par la société, par nous toutes et tous. Les coûts en termes d’impact sur la santé sont colossaux. L’épidémie de maladies chroniques (cancers, maladies neurodégénératives…), outre toutes les souffrances qu’elle occasionne, ne fait qu’appauvrir la collectivité. Nous ne pouvons accepter que la santé soit sacrifiée sur l’autel de la prospérité de l’industrie agro-alimentaire et chimique.
Nous ajoutons :
L’évaluation des risques qui précède la mise sur le marché des pesticides n’est pas complètement maitrisée par les toxicologues et elle est tout à fait INSUFFISANTE :
- l’étude de la toxicité à long terme n’est pas requise
- les effets cumulatifs ne sont pas évalués
- les co-formulants passent sous le radar
- l’effet sur les bébés est mesurée en fixant son poids de référence à 9kg l’adolescent à 60 kg
- les études épidémiologiques sont sous estimées ; seules les bonnes pratiques de laboratoire produites par l’industrie sont prises en compte et elles sont souvent illisibles pour les évaluateurs …
- les métabolites – produits de dégradation des substances actives des pesticides – ne sont pris en compte que s’ils ont été jugés pertinents
- la perturbation endocrinienne doit être évaluée depuis 2018 mais des dizaines de pesticides qui sont à l’étude sur ce critère continuent à être provisoirement autorisés en attendant les résultats de ces études …
Dans ces conditions, il est impossible d’affirmer qu’un pesticide autorisé est sans risque.
Il suffit d’un détour par la France pour comprendre la gravité du problème : certaines maladies comme certains cancers ou la maladie de Parkinson sont désormais reconnues comme maladies professionnelles chez les agriculteurs exposés aux pesticides.
Les pesticides ne sont pas une fatalité.
Les alternatives aux pesticides existent ; nos agriculteurs bio le prouvent tous les jours, depuis des décennies parfois! Chez Nature & Progrès, nous le démontrons à travers différentes actions et outils : venez à la rencontre de notre réseau de producteurs bio et locaux, à la découverte de la campagne Vers une Wallonie Sans Pesticides qui documente sur et avec les acteurs de terrain les pratiques alternatives aux pesticides culture par culture, regarder notre film-documentaire intensif ces agriculteurs alliés de la terre qui suit 3 parcours bio inspirant le temps d’une saison en grandes cultures bio, etc.
Aujourd’hui, nous ne pouvons plus rester silencieux. Alors que des auditions auront lieu les 24 juin et 8 juillet, nous voulons que la voix des citoyen·nes compte, aux côtés de celle des médecins, des chercheurs, des soignants.
Il faut du courage et de l’accompagnement des acteurs pour changer nos modèles de production, mais c’est nécessaire pour notre santé et celle de la terre !
[1] Pesticides : Professionnel.le.s de la santé et scientifiques, signez notre réponse à la ministre wallonne de l’Agriculture, Mme Dalcq. – Docteur Coquelicot