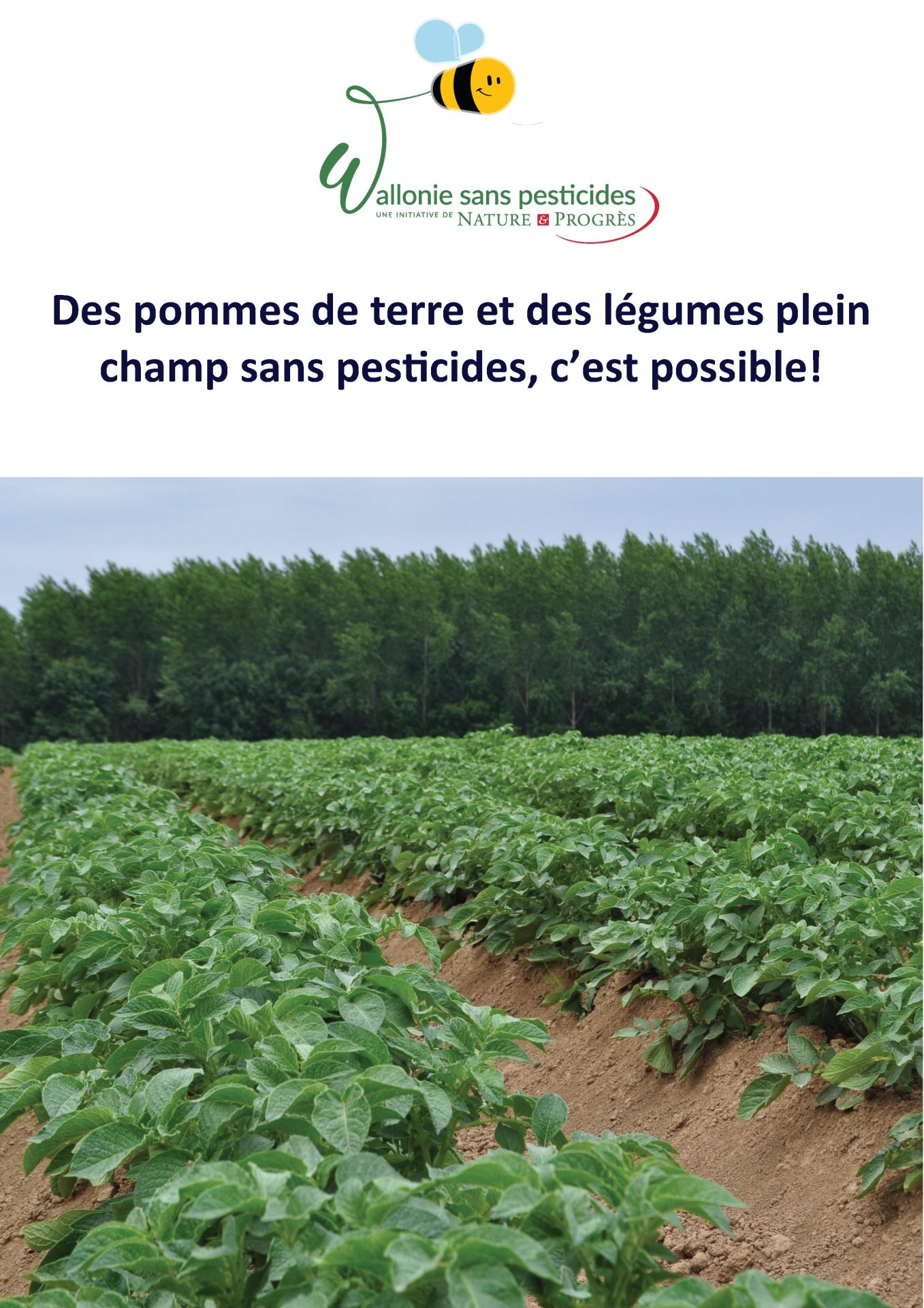Pesticides à Bruxelles : des organisations se mobilisent aux côtés de la Région Bruxelles Capitale
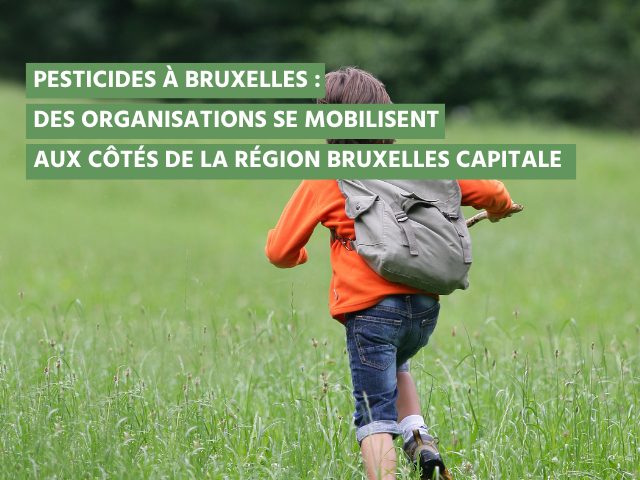
© Adobe Stock, tous droits réservés
17 décembre 2024
Communiqué de presse
Pour protéger la santé et l’environnement des Bruxellois·es, Nature et Progrès, PAN-Europe, We Are Nature Brussels et la Société royale apicole de Bruxelles et environs (SRABE) ont décidé de se mettre aux côtés de la Région de Bruxelles-Capitale, attaquée par Belplant pour avoir adopté un arrêté visant à mieux encadrer l’utilisation des pesticides.
Suite à l’Ordonnance du 20 juin 2013, les pesticides chimiques étaient déjà interdits dans la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) dans certaines zones fréquentées par le grand public (espaces publics, crèches, écoles, maisons de repos, zones Natura 2000, etc.). Le 6 juin dernier, le gouvernement de la RBC a adopté, en troisième lecture, un arrêté plus ambitieux qui étend l’interdiction de principe à tout le territoire de la RBC, y compris aux jardins et parcs privés ainsi qu’aux surfaces agricoles consacrées à la production végétale, étant entendu qu’une période transitoire de six ans est octroyée pour ces dernières.
L’association Belplant, qui représente Bayer, Syngenta et d’autres producteurs de pesticides, a intenté un recours en annulation contre cet arrêté devant le Conseil d’État. Pour la RBC et les quatre organisations qui se sont portées parties intervenantes volontaires dans un recours déposé ce lundi 16 décembre, ce recours est non fondé et contraire au droit européen.
» Il existe une directive sur l’utilisation durable des pesticides, la Directive SUD. Celle-ci impose des obligations concrètes, dans le chef des Etats membres pour protéger l’environnement et les citoyens de la contamination des pesticides, dont les risques ne sont plus à démontrer. La RBC a adopté un arrêté ambitieux visant à implémenter cette Directive sur le territoire hétérogène et spécifique que constitue la RBC. Mais force est de constater que cela dérange l’industrie. » précise Virginie Pissoort, responsable de plaidoyer chez Nature et Progrès et auteure du recours.
La spécificité de la région bruxelloise, densément peuplée mais également composée de superficies agricoles et de nombreux espaces verts est une réalité qui n’a pas échappé à l’association « We Are Nature. Bruxelles », également partie intervenante dans cette procédure.
» L’usage répété des pesticides mortifie les sols, qui deviennent imperméables aux eaux de pluie, augmentant ainsi le risque d’inondation à Bruxelles. Les pesticides empêchent également les sols de jouer leur rôle de puits de carbone et de régulateurs de la température dans une ville déjà saturée par la bétonisation. Les terrains non construits doivent absolument être maintenus comme tels et rester des sols vivants. Ils sont nécessaires pour la biodiversité, pour notre santé, et pour nous adapter aux effets du changement climatique » soutient Jean Baptiste Godinot, président de l’association « We Are Nature Brussels.
Les obligations en matière de restriction de l’utilisation des pesticides et de réduction des risques liés aux pesticides, imposées par la Directive SUD ne sont que très faiblement mises en œuvre par les Etats membres. Nonobstant les plans de réduction des pesticides, leur commercialisation ne diminue pas réellement et des pesticides dangereux et toxiques sont encore présents sur le marché. La RBC dont la route vers le « Zéro pesticide » avait été amorcée en 2013 fait figure d’exemple dans la Directive SUD.
Pour Martin Dermine, directeur de PAN Europe: « L’utilisation de pesticides génère des nuages de produits chimiques qui voyagent parfois sur de longues distances. Les Bruxellois peuvent s’enorgueillir que leur région soit la première au sein de l’Union européenne à respecter une directive vieille de 15 ans, en prévenant sa population de l’exposition aux pesticides et en protégeant son environnement ».
La RBC a déjà déposé son mémoire en réponse à la requête en annulation de Belplant, mais pour les organisations intervenantes, l’intérêt de l’acte attaqué est tel qu’elles demandent au Conseil d’État d’être parties prenantes à la cause, aux côtés de la RBC.
Pour Christine Baetens, administratrice de la Société Royale Apicole de Bruxelles et Environs (SRABE), » il a été clairement démontré que les pesticides sont extrêmement toxiques pour les abeilles et les autres pollinisateurs. Ils modifient leur comportement et affectent leur capacité de reproduction. Or, les abeille sont les véritables chevilles ouvrières de l’agriculture, grâce à leur rôle de pollinisateur. Une initiative comme celle de la RBC de restreindre l’utilisation des pesticides les plus toxiques est une nécessité. «
Il appartiendra au Conseil d’État de se prononcer sur l’intérêt des quatre associations à intervenir dans ce contentieux et de juger de la recevabilité de leur requête.
Pour le reste, la procédure en annulation suivra son cours habituel : échanges d’écrits, avis de l’Auditeur, audience, etc. Un arrêt du Conseil d’État sur le bien-fondé de la requête en annulation n’est pas attendu avant l’été 2026. D’ici là, les pesticides autres que ceux à faible risque seront interdits, sauf dérogation, et une période de transition spécifique sera prévue pour les agriculteurs, que la RBC entend accompagner dans cette transition.