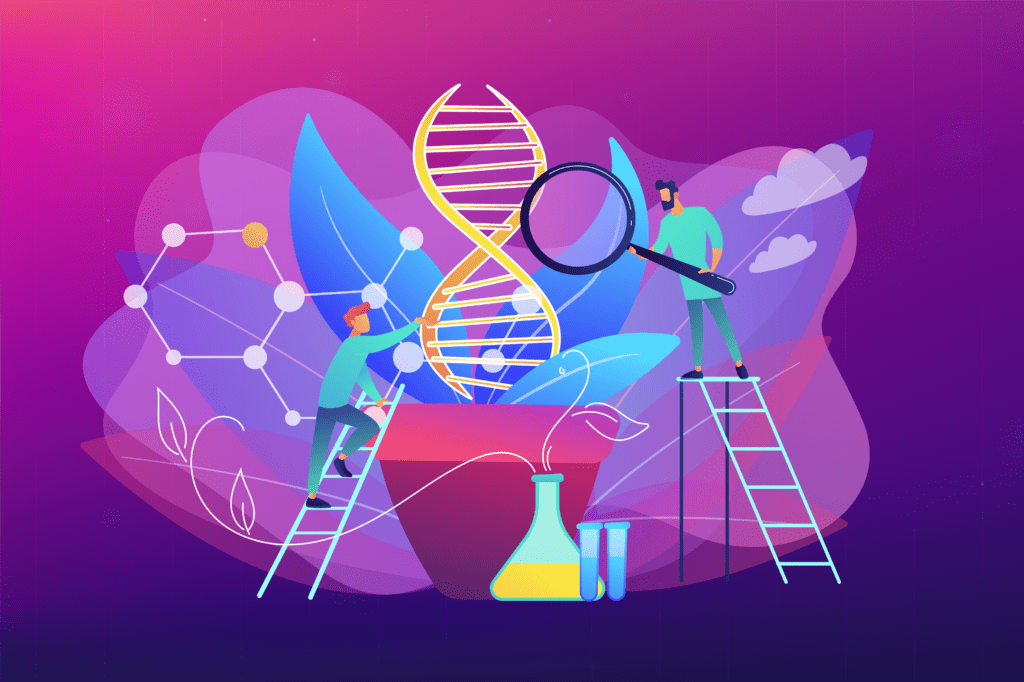De nouveaux OGM, cachés, sont à nos portes : il faut conserver un étiquetage et un contrôle avant toute dissémination

© Adobe Stock, tous droits réservés (déréglementation nouveaux OGM)
Au début des années 2000, un vaste élan citoyen a conduit à l’arrêt des cultures OGM en Europe et au boycott des aliments contenant des OGM. Ceci grâce à la réglementation européenne relative aux OGM (Directive 2001/18/CE). Mais plus récemment, des multinationales ont décidé de mettre au point des techniques nouvelles afin de produire de nouveaux OGM. Ces nouveaux OGM et techniques sont déjà déréglementés dans plusieurs régions du monde et le lobby des biotechnologies déploie des efforts considérables pour les déréglementer en Europe également.
Ce lobby s’est fortement amplifié depuis l’Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne de juillet 2018 selon lequel les nouveaux OGM doivent être considérés comme des OGM à part entière et relever de la législation OGM. A présent, ce lobby culmine après la publication du Pacte Vert Européen et de la Stratégie de la fourche à la fourchette par lesquels la Commission s’est engagée à s’éloigner fondamentalement de l’agriculture industrielle. Avec un objectif de réduction de 50% de l’utilisation des pesticides et une croissance de l’agriculture biologique de 25% d’ici 2030, cela crée une crise existentielle pour les entreprises (dont Bayer, BASF, Corteva, Syngenta) qui dominent à la fois le marché des pesticides et des semences.
La situation en cas de déréglementation
Cette déréglementation signifierait qu’il n’y aurait plus, avant autorisation de ces nouveaux OGM, d’analyse de risques pour la santé et l’environnement, ni d’exigence de traçabilité et d’étiquetage. Le consommateur n’aurait plus le droit de choisir ses aliments et cela entraverait davantage encore la liberté de l’agriculteur et causerait d’inacceptables risques pour l’environnement et la santé.
Fin avril 2021, la Commission a publié un document de travail sur le statut des nouvelles techniques génomiques. Elle estime que la réglementation actuelle sur les OGM est inadaptée aux nouvelles techniques génomiques et propose d’exempter notamment les techniques d’édition du génome de la Directive 2001/18/CE. Vingt ONG et organisations paysannes belges et de nombreux autres groupements en Europe ont répondu point par point à ce document (voir version résumée et complète) et demandent de laisser les nouveaux OGM dans la 2001/18/CE. La DG Santé de la Commission reprend à son compte bon nombre des revendications et arguments de l’industrie. Ce document est dangereux car susceptible de mal informer et d’orienter les discussions et positions des Etats membres.
En 20 ans, rien n’a changé…
Il y a plus de 20 ans, les promesses d’avantages des OGM de première génération des firmes produisant à la fois pesticides et semences OGM étaient déjà de nourrir le monde et de lutter contre la sécheresse, de réduire l’utilisation de pesticides, d’améliorer la qualité nutritionnelle, l’augmentation des rendements et une technologie maitrisée. A présent, les arguments sont identiques.
La Commission affirme, comme l’industrie, et de façon non étayée que le développement des nouveaux OGM permettrait une réduction de l’utilisation des pesticides. Nous nous attendons au contraire et demandons de réorienter les budgets de recherche vers l’agriculture bio et l’agrobiologie. Après plus de 20 ans, les OGM qui sont importés en Europe pour nourrir nos animaux d’élevage intensifs sont à plus de 95% des plantes gorgées de pesticides, qui contiennent des insecticides ou tolèrent des herbicides en les absorbant sans mourir (dont Glyphosate et Roundup). De nombreuses études montrent, qu’après quelques années, il se produit une augmentation de l’utilisation de l’herbicide prescrit pour sauver la culture envahie par des adventices devenues elles-aussi, tolérantes à l’herbicide. Et le recours, in fine, à d’autres herbicides s’ensuit. Les OGM contenant des insecticides provoquent rapidement la résistance de certains insectes et d’autres insecticides seront alors utilisés.
Récemment, une enquête du Centre Commun de Recherche (CCR) centrée sur les nouveaux OGM au stade pré-commercial montre que le groupe de caractères le plus important est celui de la tolérance aux herbicides.
La Commission et l’industrie estiment que les nouveaux OGM pourraient solutionner des effets des changements climatiques. Toutefois il est difficile de produire des plantes résistantes à la sécheresse car ce trait dépend de plusieurs gènes. Il faudrait les manipuler successivement, ce qui entrainerait encore davantage d’erreurs génétiques. D’autre part, l’industrie tente de modifier la flore du rumen des bovins pour limiter leurs émissions de méthane. Mais cette flore a notamment un rôle sur l’immunité (voir rapport : Editing the Truth : genome editing is not a solution, Oktober 2021, de FOEE).
Des erreurs génétiques à prévoir
La Commission et l’industrie ignorent les preuves scientifiques des risques occasionnés par les techniques d’édition du génome fournies par la littérature scientifique indépendante récente. Si la transgénèse (technique de 1ière génération) qui insère, au hasard, un/des gène(s) étranger(s) sélectionné(s) dans le génome hôte engendre des erreurs génétiques, l’édition des gènes qui recourt à des « mutations ciblées » en des endroits choisis du génome par le biais de ciseaux moléculaires est aussi à l’origine d’erreurs génétiques.
Celles-ci surviennent sur ou hors du site d’insertion, même en l’absence d’introduction d’un gène extérieur pour guider la réparation de l’ADN coupé. Ces erreurs génétiques sont différentes de mutations se produisant dans la nature ou de celles induites par des procédés chimiques ou physiques ou lors de la sélection végétale traditionnelle car, avec l’édition des gènes, tout le génome est accessible pour des changements, même dans des zones naturellement protégées des mutations où se trouvent des gènes importants pour la survie de l’espèce. Les techniques d’édition du génome perturbent la régulation et l’organisation des gènes.
Les erreurs génétiques peuvent engendrer des traits nouveaux comme des toxines, des allergènes, des modifications du métabolisme et/ou de la valeur nutritionnelle, des impacts sur les écosystèmes. Des exemples concrets de risques potentiels chez de nouveaux OGM CRISPR sont décrits par Testbiotech.
Les tactiques de l’industrie biotechnologique pour préparer le terrain à la déréglementation
Des fonctionnaires des ministères nationaux ont été triés sur le volet pour des réunions stratégiques conjointes avec des lobbyistes ; un groupe de réflexion a mis en place un nouveau groupe de travail avec une importante subvention de la Fondation Gates pour ouvrir la voie à la déréglementation des OGM via des « récits climatiques » ; et une plate-forme de lobbying construite autour d’une lettre de signature exagérant leur soutien de la part des instituts de recherche. Il est aussi important de souligner l’implication forte du VIB (Vlaamse Instituut voor Biotechnologie) auprès des autorités belges et internationales, le VIB étant financé par le gouvernement flamand tout comme par la Fondation Bill et Melinda Gates.
Une analyse d’impact initiale (AII) qui se base sur le travail de la Commission préalablement critiqué a été publiée le 24 septembre. Elle annonce, comme un de ses objectifs, le maintien d’un niveau élevé de protection de la santé animale et humaine et de l’environnement. Toutefois elle semble vouloir démanteler la législation de l’UE sur les OGM. Une période de consultation de 4 semaines a été proposée au public par la Commission. Plus de 70.000 citoyens européens (2.250 pour la Belgique) ont notamment déclaré qu’ils jugeaient indispensable le maintien des nouveaux OGM dans la Directive 2001/18/CE. Nature & Progrès et Velt ont facilité cette consultation.
Pour Nature & Progrès, Inter-Environnement Wallonie et Corporate Europe Observatory (CEO), les nouvelles techniques de production des OGM n’ont d’intérêt que pour les firmes semencières et de production de pesticides.
Nous demandons le maintien de ces nouvelles techniques de production dans la Directive 2001/18/CE, ce maintien permettant d’évaluer l’impact santé et environnement avant toute dissémination dans l’environnement et d’obliger l’étiquetage donnant aux consommateurs une liberté de choix.