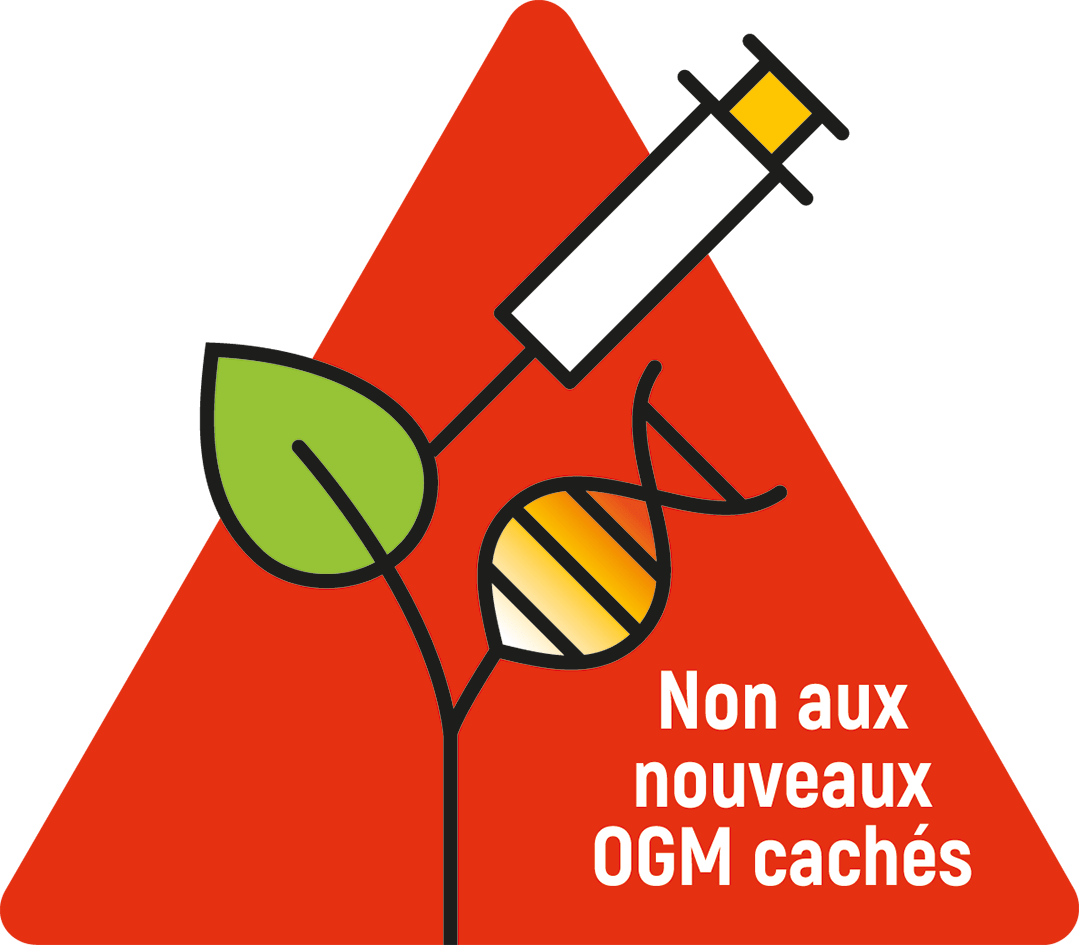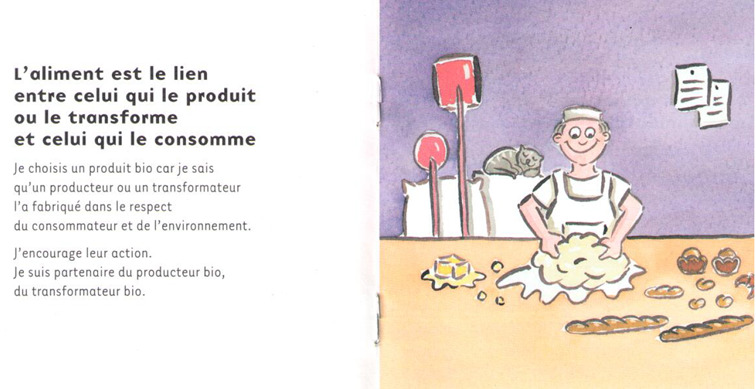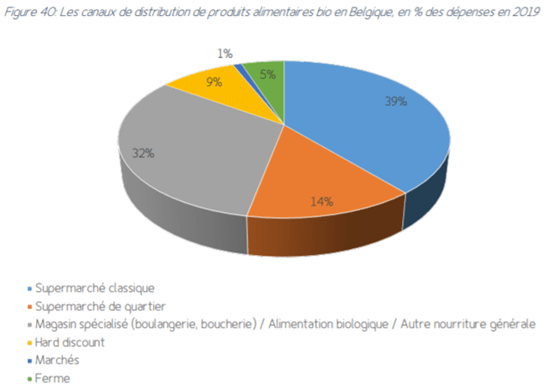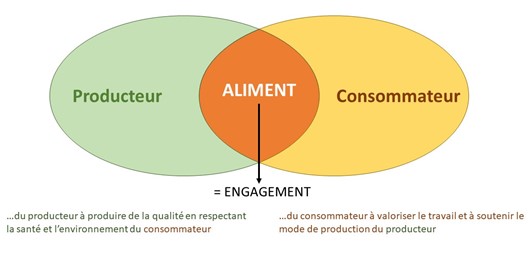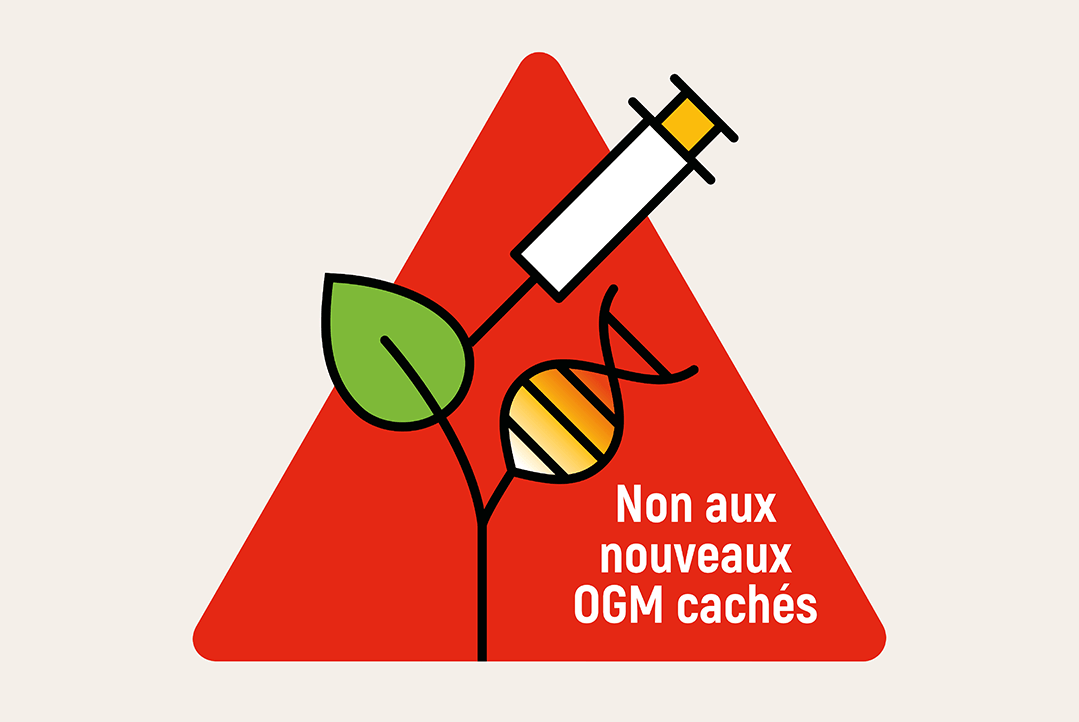Plan BEE: le miel est-il une alternative au sucre de betterave?

Plan Bee de Ciney vu d’en haut © Nature & Progrès
Certaines cultures comme la betterave sucrière sont de trop grandes consommatrices en pesticides… des pesticides chimiques de synthèse qui ont un réel impact sur notre environnement, dont la survie de nos chères abeilles. C’est de ce constat qu’est né le projet « Plan Bee » dans le cadre de la campagne de Nature & Progrès « Vers une Wallonie sans pesticides, nous y croyons ! ». L’association s’est demandé s’il était possible d’augmenter la production d’autres sucres plus respectueux de l’environnement, comme le miel des abeilles mellifères ! Les premiers résultats de l’étude sont publiés.
Une chose est certaine, pour avoir davantage de miel, il faut implanter davantage de cultures mellifères sans l’utilisation de pesticides. L’étude « Plan Bee » vise donc à étudier la faisabilité agronomique, apicole et économique de semer une diversité de fleurs sur grandes surfaces (sans engrais ni pesticides chimiques de synthèse) pour produire une multitude de produits agricoles (miel, fourrages, farines, huiles, condiments, etc.). Cela tout en accueillant l’entomofaune sauvage.
Quatre parcelles… et de nombreux partenaires !
L’étude se déroule sur des terrains de protection de captage d’eau de la SWDE dans les communes de Ciney, Orp-Jauche, Gerpinnes et Pont-à-Celles en Wallonie. De nombreux partenaires nous soutiennent également, à savoir : la Société Publique de Gestion de l’Eau, des apiculteurs, agriculteurs, semenciers, transformateurs, bénévoles, des laboratoires de recherche wallons, etc.
Un volet environnemental, agronomique et apicole
1. Environnemental
Des observateurs ont fait un inventaire de la flore sauvage et cultivée des différents sites d’étude. Une diversité d’insectes des ordres des Hyménoptères (abeilles mellifères ou solitaires et bourdons), Diptères (mouches comme les syrphes), Lépidoptères (papillons) et Coléoptères a pu être inventoriée sur une plateforme d’identification participative.
 Plan Bee de Ciney © SWDE
Plan Bee de Ciney © SWDE
Des échantillons de pollen et de pain d’abeille mellifères et solitaires ont été récoltés et analysés en termes de résidus de pesticides et d’origine botanique des fleurs butinées . Des résultats pilotes réalisés sur le site de Ciney en été 2019 montrent la présence de petites quantités (0,1 à 7 µg/kg) de pesticides dans le pollen et pain d’abeille des abeilles mellifères. Au niveau des résultats prélevés en 2020 pour les abeilles solitaires à Ciney et Orp-Jauche, nous observons des résidus d’herbicides.
Le sol et l’eau des captages ont également été analysés en termes de résidus de pesticides. A Orp-Jauche, les résultats de sol montrent la présence de 5 herbicides et 5 fongicides : molécules très rémanentes dans les sols. Heureusement, parmi les 3 néonicotinoïdes (insecticides) recherchés (imidacloprid, clothianidin et thiamethoxam), aucun n’a été détecté. Les eaux des captages des sites, quant à elles, ne dépassent pas les normes de potabilité.
2. Agronomique
L’étude n’a pu être réalisée qu’à Ciney (12 ha) jusqu’à présent. Une diversité de cultures a été implantée appartenant aux familles des Astéracées, Boraginacées, Papavéracées, Fabacées, Brassicacées, Hydrophyllacées, Polygonacées, etc. En plus de nourrir les abeilles et autres insectes, ces cultures ont pu être valorisées par la production de semences, la production de graines transformées en huiles, farines ou condiments, la production de graines pour l’alimentation animale, des foins ou ensilages fauchés après floraison ou comme engrais vert.
La difficulté pour les producteurs est principalement de trouver un marché ou d’être équipé correctement pour les travaux agricoles.
3. Apicole
Du miel a pu être produit sur les différents sites. Le miel est-il une alternative au sucre de betterave ? Pour répondre à cette question, Nature & Progrès a interviewé des consommateurs, apiculteurs et betteraviers.
• 75% des consommateurs interviewés utilisent du sucre de betterave mais ne connaissent pas les tenants et aboutissants de cette culture. La consommation de miel est plus faible que celle du sucre. Les freins à la consommation de miel sont le goût, la texture, le pouvoir sucrant et le prix. Pourtant, ¾ des participants se disent prêts à remplacer une partie du sucre par du miel.
• Les apiculteurs aiment l’interpellation « Plan Bee » quant aux pratiques agricoles. Seulement, certains craignent de remplacer un système intensif par un autre. Actuellement, la plupart des apiculteurs nourrissent les ruches avec du sucre par manque de ressources florales dans l’environnement. Pourtant, la demande de miel est inassouvie (3/4 des pots de miel viennent de l’étranger). Ce que les apiculteurs souhaitent donc, c’est restaurer l’environnement en replantant et semant des plantes mellifères.
• Les betteraviers estiment que la culture de betterave sucrière n’est pas rentable sans pesticides (pourtant le sucre de betterave bio se développe). Ils trouvent que produire davantage de miel est une bonne chose mais pensent qu’il ne pourra jamais concurrencer le sucre de betterave. Ils disent que la consommation de sucre est énorme et qu’il n’est pas possible de compenser avec des ruches. Pourtant ils sont tout à fait conscients que l’agriculture est en train de changer !
Conclusion des premières études Plan Bee
En conclusion, augmenter la production de miel est une option pour diversifier la production de sucres en Wallonie. Pour avoir plus de miel, il faut restaurer l’environnement en replantant et semant des cultures mellifères sans l’utilisation de pesticides. Certaines cultures mellifères sont rentables pour les agriculteurs, en plus de nourrir les abeilles et toute l’entomofaune sauvage.
La difficulté est de trouver un marché pour valoriser la culture et être équipé pour les travaux agricoles. Cependant, cela permettrait d’augmenter l’agrodiversité ! De plus, les abeilles mellifères et solitaires nous montrent que notre environnement est encore contaminé par des pesticides chimiques de synthèse. Il est donc urgent d’opter pour un modèle agricole alternatif sans leur usage. L’étude Plan Bee est ainsi loin d’être terminée !
Nature & Progrès a présenté ces conclusions lors d’une visioconférence le 27 avril 2021. Retrouvez-la ci-dessous !