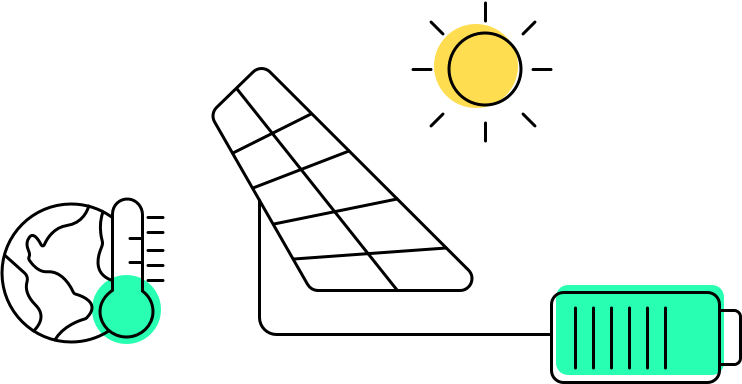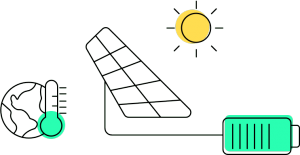Zéro-déchet : réagir à une folie ingérable
Il y a quelques années, un ami m’a fait découvrir un petit film amateur tourné, en 2004, à Buis-les-Baronnies dans la Drôme provençale. La caméra suit un homme exceptionnel, espiègle, rieur et simple. Un improbable héros obsédé par les objets jetés. Incapable d’accepter le sort qui leur est réservé, il les sauve et les collectionne. Tout : des vieux journaux, des livres, des hamburgers pourris, des roues de vélo, des téléviseurs, des frigos, des chaussures, par centaines, par milliers…
Par Guillaume Lohest

Introduction
Partout dans sa maison, à l’extérieur et même sur des terrains publics. Cette accumulation compulsive, aussi appelée syllogomanie, est considérée par les psychologues comme un trouble du comportement, parfois associé à une maladie plus large appelée “syndrome de Diogène”.
Folie ? Peut-être. Mais comme le préconisent certains anthropologues : pour comprendre une société, il faut s’intéresser à ce qu’elle rejette dans ses marges, à ce qu’elle laisse derrière elle, à ce qu’elle ne veut pas voir. Et si les « syllogomanes », ces rassembleurs de “déchets”, nous parlaient de notre folie collective ?
Une croissance exponentielle
Déchet ? Attendez. De quoi parle-t-on ? Selon une approche juridique, un déchet est “toute matière ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire” (1). C’est donc ce qu’on abandonne, ce qui est considéré comme inutilisable. Le geste de sortir les poubelles – qui nous est devenu familier – n’a cependant pas toujours existé. Selon le sociologue Baptiste Monsaingeon, “on peut parler d’une invention du déchet au tournant du XIXe / XXe siècle. Jusqu’à cette période-là, en tout cas dans les villes, on ne peut pas à proprement parler de déchets, c’est-à-dire de choses abandonnées si l’on s’en réfère à la définition juridique du déchet aujourd’hui. Les matériaux étaient alors en perpétuelle circulation”. C’est avec l’industrialisation de la production que naît le déchet, c’est-à-dire “ce qui reste” et qu’il faut cacher, enfouir, entasser dans une décharge, selon les pratiques alors en vigueur. On entre dans une nouvelle phase vers les années septante et quatre-vingt. C’est l’apparition du recyclage et du tri sélectif. “À cette époque, poursuit le sociologue, on se rend bien compte qu’on ne peut plus remplir les trous jusqu’à saturation, que, notamment, les polymères de synthèse restent visibles malgré les tentatives de contrôle de ces décharges et qu’il est donc urgent de maîtriser la situation.” Mais rien n’y fait. Au contraire même. “Les statistiques le démontrent : à partir du moment où l’on commence à penser la gestion des déchets en termes de rationalisation, c’est-à-dire le tri sélectif et l’incinération dans le meilleur des cas, les volumes enregistrés de déchets n’ont fait qu’augmenter et en particulier les quantités de matériaux destinés aux filières de recyclage. C’est particulièrement évident dans la production des plastiques. À partir du moment où l’on met en place des filières consacrées aux polymères de synthèse, aux plastiques d’emballage notamment, on se rend compte que le flux de production ne fait qu’augmenter de façon assez exponentielle.” Plus on veut le gérer, plus le déchet est considéré comme objet à traiter, à recycler, à trier… Plus il y en a !
Les chiffres actuels sont vertigineux. Ils donnent la nausée. Dans l’Union européenne, deux milliards et demi de tonnes de déchets sont produits chaque année. La part la plus importante revient au secteur de la construction (35%) et aux industries extractives (28%). Les déchets des ménages représentent 8% de cette production (2). Le plastique, symbole de modernité durant des décennies, a envahi notre environnement au point de devenir le marqueur physique d’une nouvelle époque géologique, l’anthropocène. Le recyclage, longtemps perçu comme une solution-miracle, se révèle aujourd’hui totalement inefficace. Seuls 14% des plastiques sont intégrés à un cycle de recyclage et, dans ce chiffre, 4% sont perdus dans le processus, tandis que 8% sont destinés à ce qu’on appelle un circuit ouvert, c’est-à-dire une réutilisation pour un autre produit qui, lui, sera jeté. “Bilan des courses : seuls les plastiques de type bouteilles en PET (polyéthylène téréphtalate) – qui ne représentent qu’un pourcentage très faible des plastiques consommés – peuvent se plier aux contraintes du recyclage en boucle fermée et être régénérés pour une utilisation identique. (3)” Une étude publiée par la revue Nature, en 2013, prévoit, par ailleurs, selon le scénario dit du Business as usual, si les tendances actuelles se poursuivent, un triplement de la production de déchets d’ici la fin du siècle : de quatre millions de tonnes par jour à douze millions de tonnes par jour.
L’individu face au Poubellocène
On parle d’Anthropocène, mais peut-être faudrait-il utiliser un terme plus direct. Le sociologue Baptiste Monsaingeon, dans son ouvrage Homo Detritus (4), raconte comment “dans les années 1970, des géologues français avaient proposé, sur le mode de l’humour, une classification des couches stratigraphiques les plus récentes distinguant un Poubellien supérieur (avec des plastiques) d’un Poubellien inférieur (avant les plastiques). Si ce sont bien nos déchets qui fondent la preuve indubitable de l’entrée dans cette nouvelle époque, ne faudrait-il pas plus simplement parler de Poubellocène ?”
Face à un tel désastre écologique, on comprend mieux le succès du mouvement “zéro-déchet” qui a pris de l’ampleur, ces deux dernières années, supplantant dans l’espace médiatique les célèbres Colibris de Pierre Rabhi. Le zéro-déchet est-il un nouvel avatar de cette culture des “petits gestes”, d’une écologie cantonnée à la sphère privée ? Sans doute en partie. Bea Johnson, l’autrice d’un best-seller sur le sujet, ne nie pas les difficultés et les impacts sur la vie d’un foyer : « Au fur et à mesure de ces années, on a pu s’apercevoir des avantages du mode de vie « zéro déchet ». Au départ, vous n’allez pas remarquer les économies de temps parce qu’au début, se désencombrer prend du temps… même savoir dire non prend du temps. On a l’habitude de toujours dire oui à ce qui nous est tendu. Passer chaque tiroir en revue, chaque pièce, pour mettre en place des produits réutilisables, mettre en place des alternatives… Ce n’est qu’une fois que tout cela devient automatique que l’on peut gagner du temps. (5) » L’obstacle est plus lourd qu’il n’y paraît. Une évidente charge mentale accompagne l’engagement dans une démarche zéro-déchet. Ce n’est qu’après quelques années, dit Bea Johnson entre les lignes, que cette charge mentale peut disparaître.
Le changement est social
Si l’on s’engage dans cette démarche en imaginant qu’elle va changer le monde, le risque est grand de se heurter à la désillusion face à l’inertie collective. On diminue, peut-être significativement, sa production domestique de déchets, tout en sachant qu’on ne représente qu’une proportion infime de l’ensemble des consommateurs qui, eux-mêmes, ne participent qu’à hauteur de 8% à la grande poubelle du monde. Le burn-out militant n’est pas loin. “J’ai beau regarder autour de moi, raconte une militante, depuis quatre ans d’engagement pour la transition et le zéro-déchet : un iceberg de dix milliards de tonnes s’est détaché de la banquise au Groenland, le glyphosate en a repris pour encore cinq ans, les animaux marins étouffent sous le plastique, les gens utilisent encore des poches plastiques à usage unique alors qu’elles sont censées être « interdites », la boulangerie proche de chez moi jette cent kilos de pain invendu par semaine, les pauvres oiseaux se font flinguer par les lobbys de la chasse… Alors quoi, il ne faut juste pas regarder le reste du monde ? Ouah, mais quelles sont belles ces autruches ! (6)”
Charge mentale, sentiment d’impuissance… La démarche zéro-déchet est-elle une illusion en matière de changement social ? Si on la considère uniquement comme une démarche écocitoyenne reposant sur la volonté et la conscientisation des individus, certainement. Le sociologue Jean-Baptiste Comby rappelle que ce n’est pas par l’exhortation morale ou rationnelle qu’on se met à changer de pratiques mais quand les conditions concrètes, matérielles de notre vie sont bousculées. “Par exemple, on observe que ce sont des changements biographiques d’ordre structurel qui entraînent une modification durable des modes de vie : déménagement, séparation ou mise en couple, arrivée ou départ d’un enfant, obtention ou perte d’un emploi, etc. Il s’ensuit que seule une profonde transformation de l’organisation sociale et de ses règles de fonctionnement semble à même d’engendrer des révisions massives de comportements individuels. Il paraît donc urgent de politiser le changement en cherchant à modifier prioritairement non pas les comportements individuels mais les institutions sociales à travers lesquelles les individus intériorisent des principes de classement de ce qui compte, des critères d’évaluation de ce qui est légitime, principes et critères qui gouvernent le goût pour certaines pratiques et l’aversion pour d’autres. (7)”
À l’écoute des déchets
Pour autant, ne comptez pas sur moi pour jeter la pierre aux personnes qui prennent le taureau, ou plutôt la poubelle, par les cornes. Le zéro-déchet ne sauvera pas le monde en tant que morale écocitoyenne, non. Mais la critique facile du zéro-déchet, encore moins. Il y a une nuance de taille entre le colibri invité à « faire sa part » – qui ressemble à un repli résigné sur des petits mondes isolés de l’intérêt général – et la radicalité de la formule zéro-déchet qui n’est pas destinée à s’arrêter à l’échelle domestique. Au contraire même : avant ce récent engouement citoyen, l’expression s’appliquait surtout à des programmes collectifs coordonnés sur des territoires. Le réseau Zero Waste Europe compte quatre cents villes et municipalités, essentiellement implantées en Italie et dans le nord de l’Espagne. L’une des expressions-phares de ce réseau affirme que « le zéro déchet, c’est un voyage plus qu’une destination« .
Aussi Baptiste Monsaingeon, pourtant critique face à l’obsession hygiéniste de nos sociétés occidentales, note-t-il les potentialités et la nouveauté de ce mouvement. “Je suis à la fois stupéfait et stimulé par ce mouvement du zéro-déchet. C’est surprenant de voir comment en quelques années le déchet est devenu un truc sexy, une affaire susceptible d’intéresser tout le monde y compris celui qui n’est pas forcément intéressé par les questions environnementales ou politiques. Il y a donc une sorte de mode du zéro-déchet qu’il est intéressant d’étudier. (8)”
Il y a une différence de taille, remarque-t-il, avec les petits gestes de tri et de consommation responsable car “le zéro-déchet, compris en fait comme une « réduction du recyclage » vise aussi à réduire au maximum la mise en décharge et en incinération. Se lancer dans le zéro déchet implique de se mettre à l’écoute des déchets, d’en prendre soin. Si l’on regarde de près les praticiens et les associations locales du zéro déchet, on constate que, loin d’être des individus aveuglés ou à distance des déchets, ce sont des gens qui passent les mains dedans, notamment dans la pratique du compostage. Cette attention à quelque chose qui était jusqu’à présent jeté à la poubelle m’intéresse.” Mais il rejoint tous ceux qui, aujourd’hui, insistent sur l’indispensable passage à l’échelle politique. “Si le zéro-déchet s’arrête à l’échelle domestique et du foyer, c’est vain. L’enjeu est clairement politique, technique et économique. C’est uniquement à travers la mise en place de collectifs, de mouvements élargis politiques et critiques que des mouvements sont possibles.”
De la honte à la norme
“Alors, le zéro-déchet, c’est bien ou c’est pas bien ?”, demandera le citoyen en attente d’un avis binaire bien tranché. Mauvaise question, répondrait le sage. Ne vaut-il pas mieux s’interroger sur la meilleure façon de passer de l’individuel au collectif et inversement ? Quelles sont les passerelles possibles ? Quoi qu’on en pense, et même si la tendance récente est plutôt d’attribuer l’entière responsabilité du désastre écologique aux seules grosses entreprises capitalistes, on ne peut s’exonérer tout à fait de notre rôle de consommateur. “J’estime qu’acheter, c’est voter. Si l’on achète sa nourriture en emballage, c’est une façon de voter pour l’emballage. Tout un tas de gens se disent : « Ce n’est pas à moi de changer les choses, c’est aux politiques ou aux fabricants. » Sauf que le fabricant ne fabrique que ce que le consommateur achète. Et justement, plus on achète en vrac, plus il se développera (9).” Première passerelle.
Par ailleurs, moi qui suis bien loin du zéro-déchet, je ressens de plus en plus de honte à ouvrir un emballage plastique, à m’en débarrasser dans une poubelle publique comme si j’avais bien fait mon devoir. Et cela, à cause des ami.e.s autour de moi, grâce à eux plutôt, qui manifestent au quotidien que d’autre solutions existent, qui ne coûtent pas plus cher. De la honte, et je dirais même : de la culpabilité. Aucun mot n’a plus mauvaise presse que celui-là aujourd’hui. On se sent coupable de trouver un avantage au sentiment de culpabilité. Mais réfléchissons-y une seconde. Leonard Cohen, sur un plateau de télévision, en 1992, affirmait déjà à contre-courant : “la culpabilité, c’est un très bon moyen pour savoir quand quelque chose n’est pas bon !”
Ramenée à la question des déchets, et même si évidemment la cause première de l’existence d’emballages se situe du côté des entreprises qui les produisent, il me semble souhaitable qu’une nouvelle norme sociale puisse s’installer, qui rende honteux celui qui jette énormément. Dire cela n’a rien de sexy, et c’est peut-être presque scandaleux dans une société d’individus qui n’en finissent plus de chercher à s’exonérer de toute responsabilité. Pourtant, si tout le monde aujourd’hui a intériorisé l’interdit de jeter ses déchets par terre, c’est bien parce qu’une nouvelle norme sociale a vaincu l’ancienne. Or la destinée des déchets sur cette planète nous apprend que jeter un emballage dans une poubelle, au fond, c’est le jeter par terre, mais ailleurs. “Cachez ce déchet que je ne saurais voir.”
Le zéro-déchet peut donc aussi avoir cette fonction d’instauration d’une norme sociale, qui ne tombe pas du ciel ni du bon plaisir du quidam, même si cela choque les hédonistes que nous sommes ou ceux qui aimeraient pouvoir concentrer toute la culpabilité sociétale uniquement chez les plus riches qu’eux. Deuxième passerelle : merci mes ami.e.s zéro-déchet, de donner l’exemple et de me faire honte, gentiment et indirectement. Cette honte ne me tue pas, elle nous rend plus forts collectivement.
Épilogue : “c’est pas trop joli”
A Buis-les-Baronnies, le sympathique syllogomane Christian Guienne n’est plus. Le “Diogène des Baronnies” (10) est décédé, en décembre 2009, après avoir été placé d’office, par sa tutelle et la municipalité, à l’hôpital psychiatrique de Montélimar. J’ai regardé trois fois le petit film (11) qui le suit à la trace, lui et ses montagnes de déchets. Devant ce qu’il appelle son « dépôt de frigos », parmi les oliviers et la broussaille, il rit et réfléchit tout haut, de son accent chantant : “C’est pas trop joli, mais c’est curieux quand même… C’est unique en son genre. Personne ne le fait. Y a que moi qui ai eu l’idée de mettre les souliers là.”
Deux frigos (jetés) sont remplis de chaussures (jetées). C’est curieux, oui. Les Diogène et les « syllogomanes », en quelque sorte, sont aussi dans une logique zéro-déchet. Leurs folles collections, crasseuses et ingérables, mettent sous nos yeux ce que nous croyons disparu alors que ce n’est que jeté, caché, éloigné. En un mot : ingérable.
Notes
(1) Article 2, 1° du décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
(2) Source : Eurostat.
(3) Nathalie Gontard, “Déchets plastiques : la dangereuse illusion du tout-recyclage”, L’Obs, 4 février 2018.
(4) Baptiste Monsaingeon, Homo detritus. Critique de la société du déchet, Seuil, mai 2017.
(5) Béa Johnson : « On a adopté le Zéro déchet et la vie est meilleure », propos recueillis par Martin Cadoret, Reporterre, 20 novembre 2017.
(6) “Burn-out du Colibri”, 4 février 2019 : https://lesmouvementszero.com/2019/02/04/burn-out-du-colibri/
(7) Jean-Baptiste Comby, “Les limites de la morale éco-citoyenne”, Lava, 1er octobre 2018. https://lavamedia.be/fr
(8) « Appréhender les déchets comme un symptôme, et non comme une maladie », interview de Baptiste Monsaingeon, Alter Échos n° 453, 24 octobre 2017, propos recueillis par Manon Legrand.
(9) Béa Johnson : « On a adopté le Zéro déchet et la vie est meilleure », propos recueillis par Martin Cadoret, Reporterre, 20 novembre 2017.
(10) France Culture, émission Sur les docks par Irène Omélianenko, Portraits (2/4), le « Diogène des Baronnies », 26 avril 2011.
(11) https://vimeo.com/666346 : The Collector, par Martin Hampton.