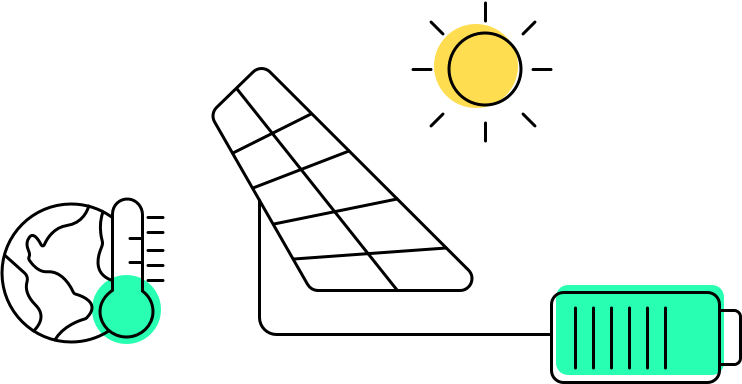« OK boomer » : deux mots valent mieux qu’un long discours
Il aura fallu quelques semaines à l’expression “Ok boomer” pour passer du monde anglo-saxon au monde francophone. Ces deux mots, lancés à un interlocuteur né au moment du baby-boom (1945-1965), signifient en quelque sorte “cause toujours”. On peut trouver cette expression géniale, ironique, bien envoyée ou, au contraire, offensante, inappropriée, injuste. Je pense qu’elle est la condensation parfaite d’une fracture générationnelle plus lourde qu’on veut bien le croire. Analysé ici depuis l’angle des enjeux écologiques et de façon provocatrice, ce “ok boomer” sonne le glas d’une vision du monde illusoire et aussi d’une certaine écologie « à la papa ».
Par Guillaume Lohest

Introduction
Début novembre 2019, lors d’une session parlementaire en Nouvelle-Zélande, Chloe Swarbrick, une jeune députée de vingt-cinq ans, est interrompue dans son intervention par un homme plus âgé. Elle est en train d’interpeller l’assemblée sur le changement climatique. “Nous sommes responsables et nous devons nous montrer responsables. Monsieur le Président, combien de dirigeants mondiaux étaient au courant de ce qui se passait et de ce qui allait se passer mais ont décidé qu’il était politiquement plus opportun de glisser cela sous le tapis ? Ma génération et les générations futures n’ont pas ce luxe. En 2050, j’aurai 56 ans. Aujourd’hui, la moyenne d’âge de ce parlement est de 49 ans.” À ce moment, des récriminations s’élèvent. Un homme d’un certain âge tente de l’interrompre. La députée lance alors un bref “OK boomer”. Puis elle poursuit. “Les institutions politiques actuelles ont prouvé qu’elles étaient incompétentes à penser autrement qu’à court terme. Le changement est si régulièrement sacrifié au bénéfice du pouvoir. Les slogans sont faciles mais il est difficile d’agir. Le changement climatique ne peut plus être sacrifié pour des commodités politiques. Le changement climatique est une vérité profondément dérangeante.”
“OK boomer” signifie simplement : “Ok, baby-boomer”. Il s’agit d’un mème, c’est-à-dire une petite phrase virale sur Internet, qui s’est popularisé dès 2018 et dont la diffusion a explosé en novembre 2019, suite à son utilisation en live par Chloe Swarbrick. L’expression renvoie celui qui parle à son appartenance à la génération née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, entre 1945 et 1965. Elle veut dire, en quelque sorte : “cause toujours, c’est facile de penser ce que tu penses quand on appartient à cette génération”. Mais, et c’est là l’essentiel, elle ne le dit pas vraiment, elle ne prend pas la peine de l’expliciter. Par ces deux mots, les jeunes générations refusent de perdre davantage de temps à expliquer pourquoi les leçons de morale ou les conseils – par exemple, les récriminations face à l’urgence climatique – sont illégitimes et ridicules quand elles sortent de la bouche d’un baby-boomer. Ce faisant, elles mettent cette génération en situation de faire son propre examen de conscience.
Vie d'une génération, mort d’un monde
Chère lectrice, cher lecteur, si tu es un baby-boomer, ne prends pas ce qui va suivre personnellement. D’autant moins, sans doute, qu’en étant membre d’une association pionnière en agriculture et en jardinage biologiques, tu fais partie d’une minorité agissante à qui on peut difficilement reprocher d’être restée les bras ballants. Toutefois, si ce n’est pas personnel, c’est donc générationnel. Il te faudra au moins accepter cela : ton appartenance à la génération de la croissance, de l’explosion de la production et de la consommation. Pour prendre une image : les boomers ont généralisé le frigo, l’ont rempli au maximum, et ont presque tout mangé à eux seuls, le temps d’une vie.
Rappelons-nous ces célèbres courbes qui décrivent la “grande accélération”, autrement dit cette période qui débute vers 1945 et s’achève de nos jours, période au cours de laquelle tous les indicateurs s’envolent à l’exponentielle : la production, la consommation, la construction d’infrastructures, les investissements, et aussi les pollutions, les émissions de CO2, le déclin de la biodiversité et la ponction sur les ressources. Cette tranche temporelle correspond exactement à la vie de la génération des baby-boomers. Et, à en croire les projections du Club de Rome dans son rapport de 1972 mais surtout vu la réalité de l’épuisement des ressources et du ralentissement de l’économie mondiale, ainsi que l’inéluctable réchauffement climatique catastrophique qui se profile, tout porte à croire que cette période de croissance stable sur une terre encore globalement habitable sera définitivement terminée endéans les dix ans. La formule est choc mais assumons-la : la durée de vie d’une seule génération aura détruit les écosystèmes et les ressources communes nécessaires aux générations à venir.
Rien à voir avec l’âge !
Certaines personnes visées par ce “Ok boomer” considèrent qu’il s’agit d’un argument insupportable car il renverrait la personne à son âge. C’est le cas du philosophe Raphaël Enthoven, qui s’insurge sur Twitter : “Comment brandir comme une vertu en soi le fait (hautement provisoire) d’être jeune ? Contrairement à l’assignation religieuse, aux pratiques sexuelles ou à la couleur de la peau, la jeunesse n’a aucune chance de dure. (1)” Ce à quoi de nombreux internautes lui répondent qu’il n’a absolument rien compris. “Boomer ne vise pas «les vieux» en général mais la génération née après la guerre et qui a connu la croissance, le plein emploi, la libération sexuelle avant le sida et les dernières heures de gloire de la retraite, tout en participant à la destruction de la planète. En un mot : la génération épargnée, entre les générations sacrifiées des guerres mondiales, et celles qui vont devoir payer l’effondrement du système économique et de l’écosystème. Le boomer, donc, pourrait parfois faire preuve de plus de bienveillance lorsque la génération suivante s’exprime (2).”
Alors, est-ce de l’âgisme, c’est-à-dire une discrimination du propos reposant sur une critique de l’âge de la personne – comme on parle de racisme ? Bien sûr que non. “Ok boomer” n’a rien à voir avec le fait que les personnes aient cinquante, soixante ou septante ans en soi. L’expression renvoie à une cohorte démographique. Ce qui est en cause n’est pas l’âge, répétons-le, mais le modèle de société et le type de discours portés par une génération. Le fait qu’elle ait aujourd’hui entre cinquante et septante ans n’est que la conséquence du temps qui passe. Il eut d’ailleurs été heureux que, dès les années septante, les premières alertes écologiques fussent mieux entendues par cette même génération, alors dans la fleur de l’âge.
Un antagonisme générationnel
Lisant ceci, chère boomeuse, cher boomer, tu continues sans doute à te demander si tu es visé.e ? Comment démêler l’appartenance à une génération d’une identité personnelle ? Comment comprendre cette réplique expéditive, ce “cause toujours”, si on ne sait pas exactement ce qu’il reproche et à qui précisément ? Justement : il ne s’agit pas d’un reproche ou d’un jugement sur des personnes mais du refus, de l’invalidation, de la mise sous silence d’un certain type de discours et d’attitudes très profondément installées. En particulier, la posture condescendante du donneur de leçons. Quand un torrent de critiques s’abat sur Greta Thunberg et sur les jeunes qui marchent pour le climat, sous prétexte qu’ils sont dans une écologie de l’urgence, de la peur, de la naïveté, dans du catastrophisme, etc., “Ok boomer” ne veut pas dire “ce que vous dites n’est pas vrai”. C’est plus profond que cela. “Ok boomer” signifie plutôt : “toutes les raisons, toute la vision du monde, toute l’expérience qui sous-tendent plus ou moins consciemment votre critique – ou vos conseils, ou vos nuances – reposent sur une pure illusion. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous considérez comme normal et raisonnable est en fait anormal et insensé ; votre vie est inscrite dans une exceptionnelle parenthèse historique qui est en train de se refermer.”
Pour mieux comprendre ce qui est en jeu, le rapport entre ce qui est en cause et qui est en cause, établissons une analogie avec ce qu’on appelle la lutte des classes. Ce concept n’a jamais signifié que tous les ouvriers étaient des anges et tous les bourgeois des salauds. Certains bourgeois peuvent prendre la défense des intérêts des ouvriers, et certains ouvriers accepter sans broncher la domination bourgeoise. Il n’en demeure pas moins qu’il y a une pertinence du concept de lutte des classes. Eh bien, on peut dire la même chose de la “lutte des générations” que suggère l’expression “Ok boomer”. Elle instaure un antagonisme entre des visions du monde liées aux caractéristiques du moment durant lequel elles émergent.
Boomer : un idéal-type
Je détaille. De quoi est faite cette posture, cette vision du monde propre au boomer ? En schématisant – à peine -, on pourrait dire qu’elle repose sur l’idée que demain sera meilleur qu’aujourd’hui si l’on agit en “bon père de famille”. Et c’est sur ce point que porte le cœur de la critique : le rapport au temps du boomer est complètement détraqué, complètement noyé dans une illusion. C’est parce qu’il a baigné dans l’idéologie des trente glorieuses, dans cette idée que l’histoire avançait vers un progrès, que les démocraties atteignaient un point d’équilibre, que la vie était une accumulation d’expériences et d’argent, que l’on pouvait toujours trouver des solutions et corriger nos erreurs, ou les erreurs du marché, en inventant par exemple la sécurité sociale pour plus d’égalité, ou en obtenant des avancées législatives pour plus d’écologie, ou encore en mettant au point des technologies plus “vertes”, en adoptant des gestes “écoresponsables”…
Bref, c’est parce qu’il est teinté plus ou moins consciemment de cet imaginaire-là que son regard sur les grands enjeux écologiques est complètement inadapté. Car ces grands enjeux – climat, biodiversité, épuisement des ressources – sont marqués du sceau de la rupture, du point de bascule vers des catastrophes irréversibles. Les grands enjeux écologiques brisent la ligne de l’histoire, quand le boomer continue de voir l’histoire comme une continuation de son monde illusoire. Pour être un peu plus concret, disons enfin que les conditions matérielles d’existence du boomer – sa maison remboursée depuis longtemps, son livret d’épargne, sa pension assurée, son éventuel petit appartement de rapport – l’aident à poser sur les rapports du GIEC un regard plus serein – ou plus distrait. Les millenials et la génération Z ne se font, quant à eux, aucune illusion sur le fait qu’ils ne pourront plus bénéficier de cette situation exceptionnelle.
Il s’agit là d’un schéma, ce qu’on appelle en sociologie un idéal-type. Cela signifie qu’au fond, cette attitude n’est pas strictement réservée aux baby-boomers. Des personnes nées avant 1945 ou après 1965 peuvent être également imprégnées de cette vision du monde, avoir hérité d’un confort matériel conséquent et prodiguer des conseils insupportables à tous ceux qu’ils estiment trop idéalistes, trop naïfs, trop radicaux, trop ceci, pas assez cela. Il n’empêche que cette vision du monde et la condescendance qu’elle entraîne sont concomitantes avec la génération des boomers.
Trois nuances de boomer
Jusqu’où porte cette critique ? Concerne-t-elle uniquement les vieux messieurs climatosceptiques et anti-Greta Thunberg – et par extension, les petites résonances inavouables en chacun de nous de cette attitude extrême ? Je ne le pense pas. Car ce n’est pas seulement le contenu des idées qui est visé mais plus largement la manière d’être : le rapport au temps, aux autres, au monde. Aussi, à gros traits, je propose ici trois profils de boomers opposés dans leurs visions politiques mais qui ont en commun cette condescendance générationnelle de ceux qui ont une situation, un point de vue sûr de lui, qui refuse d’être mis en cause :
– le climatosceptique caricatural, disons Donald Trump ou n’importe quel autre homme plutôt riche qui considère que le réchauffement climatique est une préoccupation non pertinente. Le slogan de ce boomer de type 1, marqué par le déni et la mégalomanie, pourrait être “laissez-moi continuer à vivre sans me soucier de l’avenir des enfants des autres.”
– le libéral responsable, comme les philosophes Pascal Bruckner et Raphaël Enthoven : celui-là ne nie pas les problèmes écologiques mais il ne les regarde que comme des données périphériques qui n’entament pas son logiciel de pensée. Il a lu des articles et des rapports, mais il ne les digère pas. Ce boomer de type 2 est, de loin, le plus répandu et le plus agaçant car il est bavard et très sûr de son fait. Pensant avoir compris les enjeux de l’époque, il se donne un droit permanent à parler de la bonne façon d’envisager l’avenir car il a tiré les leçons de mai 68. Il sermonne les jeunes catastrophistes. Il pense que c’est le propre de la jeunesse d’être agitée, intransigeante et idéaliste. Il peut être virulent car il est intelligent : il perçoit et il devine – sans l’accepter – qu’il est à côté de la plaque. Et cela l’enrage.
– le parfait consommateur durable, que certains n’hésiteront pas à appeler le « bobo », constitue le boomer de type 3 : celui qui s’ignore ! Fraîchement pensionné, sa maison entièrement rénovée avec des matériaux écologiques, recouverte de panneaux photovoltaïques et achalandée de légumes biologiques, il prend le train et participe aux marches pour le climat avec un sourire jusqu’aux oreilles. Il trouve les jeunes formidables et il se dit qu’enfin, ça y est, ils vont changer le monde. Il ne se rend pas compte que sa perfection écologique est cosmétique, que son empreinte sur la planète reste supérieure à celle d’un travailleur pauvre pas du tout écolo, et que sa panoplie d’actes et de matériel “verts” est totalement hors d’atteinte – et hors de prix – pour les générations qui le suivent. Il sert d’exemple, il se veut bienveillant, il fait parfois du yoga et se réjouit de la reconnexion à la nature. La nuit, il dort bien, sur son matelas naturel à trois mille euros. En l’observant, les jeunes qui sont dans le même GAC que lui bavent d’envie, et de jalousie, face à cette vie saine et harmonieuse qu’ils n’auront jamais. Sa joie tranquille est littéralement insoutenable.
Se défendant, il s’enfonce
Chère boomeuse, cher boomer, je provoque et vous bouillonnez peut-être. Vous n’êtes pas les seuls. En me promenant sur la twittosphère, j’ai relevé l’arsenal argumentatif développé par les boomers. Ils avancent ceci, en vrac, pour leur défense : que leur enfance fut plus dure que la nôtre, que les progrès de la médecine rendent nos générations encore plus chanceuses, que les statistiques montrent que les jeunes consomment davantage et encore moins durable qu’eux, qu’il est incohérent de vouloir sauver la planète et garder son smartphone, qu’il y a toujours eu des prophètes de malheur et qu’on s’en est toujours sortis, qu’ils ont construit une société prospère et pacifiée quand les jeunes générations, elles, n’ont eu qu’à la recevoir toute faite, etc. Bref : ils ne sont pas parfaits mais leurs descendants sont encore bien pires, ces éternels adolescents collés à leurs écrans du matin au soir !
Le propre de cet argumentaire est de s’autodétruire tout seul. Chaque récrimination sonne comme une preuve supplémentaire que cette génération refuse de se remettre en question, refuse de comprendre qu’il ne s’agit pas de traquer les vertus individuelles des uns et des autres mais de mettre à nu la péremption d’un modèle de société péremptoire. Au fond, on attendrait du boomer qu’il cesse de se justifier individuellement pour observer collectivement, avec nous, que la ligne du temps s’est brisée et qu’il n’y aura pas de continuation de son monde. On attendrait du boomer qu’il se laisse sidérer par l’impasse collective de sa société. Toute parole qu’il profère pour tenter de se rassurer, pour comparer notre jeunesse à la sienne, pour nous conseiller, tant qu’elle nie cette sidération face à un horizon bouché de toutes parts, ne mérite pas d’autre réponse que : ok boomer.
Aussi un déchirement
Dernière précision, si tout ceci vous rend amer et semble faire de nous des mauvais fils et des mauvaises filles. Dans “ok boomer”, il y a aussi de la douceur, la familiarité de l’enfant qui parle à ses parents. C’est la reconnaissance, en un seul mouvement expéditif, de tout ce qui nous a été donné. Il y a donc bien sûr de la gratitude. Notre aveu est complet : mis à part cette conscience déchirante, nous sommes faits du même monde puisque vous nous y avez élevés. Notre révolte est donc aussi une blessure : ce monde que vous nous avez transmis, cela crève les yeux qu’il est définitivement non renouvelable, mais cela nous crève aussi le cœur car c’est le nôtre, notre berceau, nous en profitons sans cesse et, quoi qu’on dise, nous en aimons, comme vous, bien des aspects. Bien davantage même que ce que nous nous avouons à nous-mêmes…
Ainsi, cette expression n’est pas seulement un “mème” subtil et drôle, un buzz, un bon mot, un trait d’esprit habile et léger. Elle dit, en creux, une fracture générationnelle douloureuse et polémique, chargée d’émotions contradictoires, qui mérite d’être décrite si l’on souhaite cesser de s’illusionner sur l’avenir et sur les changements à opérer. Quant à cet article, il n’est pas certain qu’il puisse atteindre son objectif. Peut-être est-il vraiment impossible pour un boomer de se désaxer de son point de vue pour tenter d’adopter, un instant, le nôtre. Dans ce cas, l’expression est d’autant plus nécessaire, inexplicable et donc irremplaçable. Avec leurs nuances de cynisme, d’humour, de lassitude et de tendresse, ces deux petits mots seront toujours plus puissants qu’un long discours. En outre, je suis sûr que vous allez me dire qu’il ne faut pas opposer les générations, qu’il faut rester unis et affronter ensemble les défis de demain. Ok, boomer.
(1) Tweet de Raphaël Enthoven, le 28 novembre 2019.
(2) Double tweet de Pierre Monégier, le 28 novembre 2019.