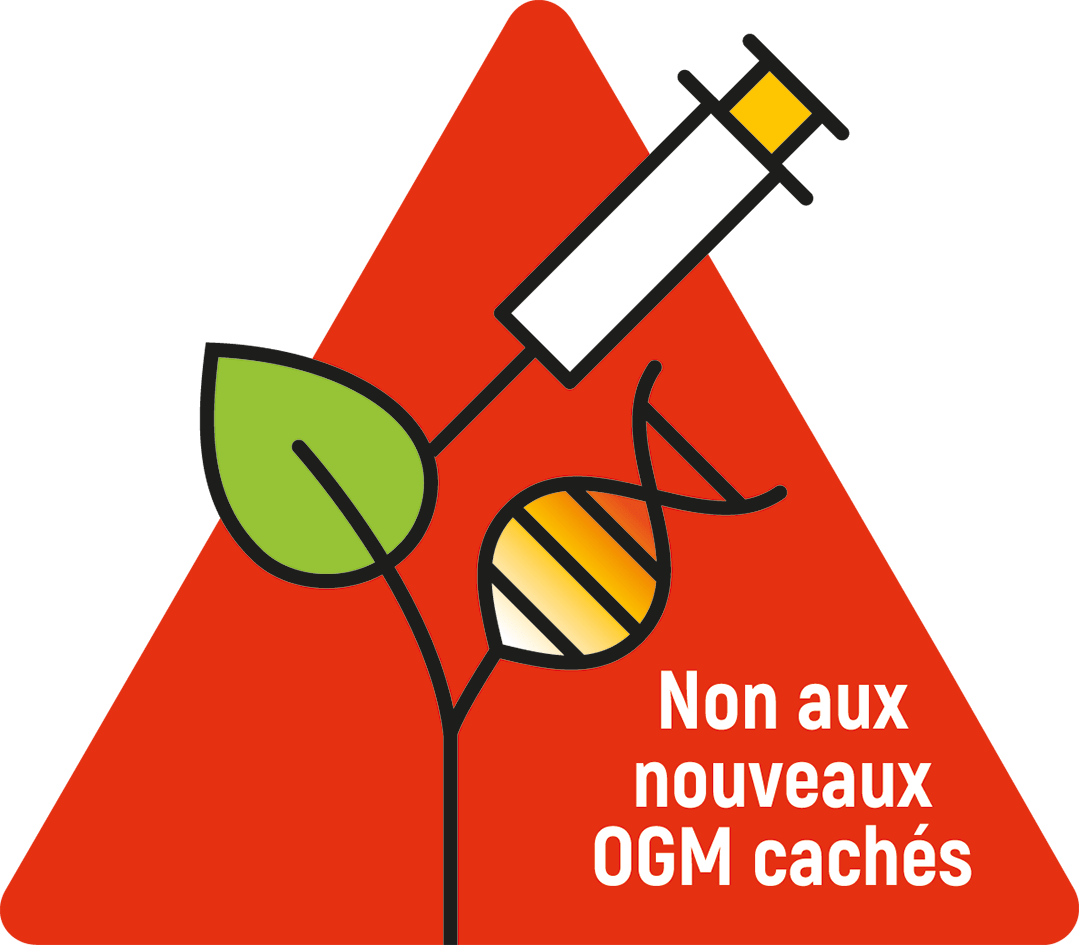Tourner le dos aux pesticides, il y a urgence !
Rendus publics le 4 octobre dernier, les résultats du Biomonitoring humain wallon, réalisé par l’Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) – voir : https://www.issep.be/biomonitoring/ – ne sauraient être accueillis avec indifférence. On nous démontrera, certes, que certaines valeurs sont en baisse – métaux lourds, bisphénols, etc. – et que, dans l’ensemble, tout cela n’est pas pire qu’ailleurs en Europe… L’imprégnation de nos corps par d’innombrables substances potentiellement toxiques n’en reste pas moins extrêmement préoccupante.
Par Marc Fichers

Introduction
Nous n’y pouvons rien ou à peu près, sauf peut-être en ce qui concerne les fumeurs… Ces innombrables substances sont largement présentes dans notre environnement, intérieur et extérieur – eau, air, sol -, mais aussi dans notre alimentation et dans bon nombre de produits que nous utilisons dans notre vie quotidienne – des matériaux divers, des produits de nettoyage, des jouets, etc. Le Biomonitoring, réalisé par l’ISSep à la demande de la Région Wallonne – dans sa première phase concernant nouveau-nés, adolescents et adultes âgés de vingt à trente-neuf ans -, nous livre une estimation réelle et globale de l’exposition de ces catégories de personnes à une cinquantaine de substances chimiques, toutes sources et voies d’exposition confondues. Il sera donc particulièrement utile pour effectuer un suivi de ces expositions. 828 Wallons et Wallonnes – 284 nouveau-nés, 283 adolescents et 261 adultes de vingt à trente-neuf ans – se sont donc portés volontaires afin de mesurer, en toute confidentialité, leurs niveaux d’imprégnation. Des analyses complémentaires seront réalisées par la suite, afin de déterminer l’origine précise de certains polluants, autour des broyeurs à métaux par exemple…
Les pesticides nous empoisonnent toujours la vie !
Pour ce qui concerne Nature & Progrès et son action : rien d’étonnant, hélas ! Le glyphosate – pourtant interdit en Belgique, depuis 2017, pour l’usage privé et dans les espaces publics – est présent dans presque un quart des échantillons d’urine. Nous avons maintes fois expliqué que cette molécule active ne voyage jamais seule. Le produit commercial, qui est effectivement utilisé et impunément répandu dans notre environnement et jusqu’à l’intérieur de nos corps, se compose également de toute une série de co-formulants dont nous savons finalement fort peu de choses, mais qui ne sont jamais visés par les études de toxicité. Ces substances mystérieuses, considérées à tort comme sans effet biologique, se drapent, en effet, dans le secret industriel pour échapper à tout contrôle. Mais de plus en plus d’études montrent que le « produit formulé », c’est-à-dire la substance active + ses co-formulants, est souvent beaucoup plus toxique que la seule substance active !
D’une manière plus générale, nos craintes semblent, malheureusement, se vérifier en ce qui concerne les plus jeunes d’entre nous : les concentrations mesurées chez les adolescents sont, en effet, significativement supérieures à celles des adultes, pour la grande majorité des pesticides actuellement utilisés. De quoi s’inquiéter pour les générations futures ?
La croyance dans la nécessité des pesticides est une forme d’obscurantisme ! Il y plus d’un demi-siècle déjà, les industriels des pesticides distribuaient, entre autres, le Chloropyrifos, un insecticide organophosphoré qui a des effets génotoxiques et neurotoxiques. Des études démontrèrent également un retard mental chez les enfants exposés à ces poisons. Les industriels l’ignoraient-ils ? Sans doute pas plus que les industriels du tabac n’ignoraient les effets cancérogènes des cigarettes. Leo Burnett, le Marlboro Man n’est plus là pour en témoigner. Les fondateurs de Nature & Progrès, quant à eux, étaient déjà conscients que ces poisons n’apporteraient rien de bon à l’agriculture et à l’alimentation humaine. Ils firent le choix de tabler sur la bonne gestion des sols pour produire une alimentation saine, dans le respect des lois de la nature et en refusant l’usage des pesticides chimiques de synthèse. Depuis tous ce temps, les agriculteurs bio perfectionnent leurs techniques de production. Ils l’ont fait seuls car les centres de recherche publics ont toujours choisi la voie chimique qui leur semblait un gage de modernité. Ces procédés chimiques sont aujourd’hui totalement dépassés mais le mythe moderniste subsiste.
Les techniques de l’agriculture biologique sont performantes et la production bio est plébiscitée par les consommateurs. Un agriculteur wallon sur sept travaille en bio. Sans la moindre gouttelette de pesticide chimique de synthèse ! A telle enseigne que la Wallonie a choisi de se doter d’un plan ambitieux qui vise 30% de bio en 2030. Fort de ce constat, fort de l’efficacité des techniques de la bio, Nature & Progrès a lancé, il y a près de cinq ans sa campagne Une Wallonie sans pesticides, nous y croyons ! dont le but est de libérer notre région des pesticides, puisqu’il est communément admis que leur usage – et c’est un prudent euphémisme – « n’est pas sans danger ». Le remplacement pur et simple des pesticides chimiques de synthèse par des alternatives non chimiques est possible. Absolument possible. Les alternatives existent, nous les avons répertoriées et testées : en prairies, en maïs, en céréales, en pommes de terre… Et nous ne demandons qu’à poursuivre notre démarche. A cet effet, Nature & Progrès organise des rencontres entre agriculteurs, bio et non bio, pour en faire la démonstration… Nous ne craignons donc plus de dire qu’un changement radical est non seulement possible, mais totalement nécessaire, car la biodiversité est, par ailleurs, dans un état lamentable. Or ceci est dû, principalement, à l’emploi, insupportable car totalement inutile, de pesticides dans nos campagnes. D’une manière très générale, la pollution de notre environnement appelle également un changement radical de paradigme.
L'approche toxicologique, seule, ne suffit pas…
Les toxicologues ont donc sans doute raison de dire que les particules fines, dans nos villes, font statistiquement plus de dégâts que les pesticides. Ce sont leurs chiffres et ils les connaissent mieux que nous… Mais qu’est-ce que cela change ? Changer d’agriculture est une nécessité globale qui s’articule autour de plusieurs nécessités vitales : la fertilité d’un sol vivant, le maintien de la biodiversité et le respect de l’environnement qui nous entoure, pour n’évoquer que ces trois-là, sont le fondement de toute forme d’agriculture durable.
Pourtant… Pourtant, chaque année, les Centres de recherches et d’encadrement publics – financés avec l’argent du contribuable – n’ont de cesse promotionner l’usage des pesticides. Chaque année, au printemps, ils publient des pages entières dans les journaux agricoles pour faire l’apologie du désherbage chimique, en maïs par exemple. Pas la moindre fichue petite ligne mentionnant l’usage du désherbage mécanique alors que cette alternative fonctionne à la perfection.
Pourtant… Quand l’Europe bannit les dangereux néonicotinoïdes, la Belgique croit malin d’y déroger. Car il arrive, malgré tout, que des pesticides soient interdits lorsque leur nocivité est à ce point patente que les firmes n’ont plus aucun moyen pour les défendre. Le Chloropyrifos, lui, fut finalement interdit… mi-2019 ! Après cinquante-cinq années de « bons et loyaux services » pour la cause de la destruction de la biodiversité ! Une perte de la biodiversité telle que des insectes ravageurs ne rencontrent plus leurs prédateurs et se développent de manière exponentielle : mouches de la cerise, drosophiles « suzuki », pyrale du buis…
Les résultats du grand travail de l’ISSeP ne peuvent donc, en aucun cas, être analysés au microscope, fut-ce ceux d’éminents toxicologues. Ils ne peuvent prendre leur sens qu’avec le recul macroscopique, la vision globale qu’impose l’écologie. Qu’il demeure des traces de Chloropyrifos dans 90% des échantillons d’urine des ados et des adultes de l’étude n’est donc pas un fait anecdotique qui nous remet en mémoire le « bon vieux temps ». C’est une source historique, gravée dans nos chairs, qui doit à tout moment nous rappeler les douloureux errements du passé ! Voulons-nous « travailler avec la nature » ou définitivement « en finir avec le mythe de la nature saine » et nous défendre contre ce qu’elle nous apporte, en optant pour la fuite en avant dans les produits létaux ? En oubliant que la nature ne fait, le plus souvent, que réagir à des déséquilibres de nature anthropique, c’est-à-dire causés par l’action de l’homme – et dont le réchauffement du climat n’est pas le moindre. Se réconcilier ou se combattre. Il n’y a plus de moyen terme. Et nous ne sommes pas en position de force !
Notre environnement est pollué par les pesticides
Le Biomonitoring humain wallon confirme ce qu’annonçaient les études Expopesten et PROPULLP, déjà dues au même ISSeP. Des mesures doivent, à présent, être prises et Nature & Progrès a déjà interpellé les autorités compétentes afin que les choses changent.
En direction du grand public et des agriculteurs, nous allons :
- développer notre campagne Une Wallonie sans pesticides, nous y croyons ! qui a mis en évidence les opportunités qu’offrent les alternatives aux pesticides ; de nombreuses rencontres entre agriculteurs bio et non bio, en présence de consommateurs, l’ont démontré ;
- intensifier ces rencontres et diffuser plus largement encore l’information sur les alternatives qui ressort de ces rencontres ;
- continuer notre travail de sensibilisation en direction des consommateurs. Car il s’agit bien d’être informé, plus que de subir la propagande de grands groupes agroindustriels.
En direction de l’autorité fédérale, nous allons :
- continuer les actions en justice entamées avec le Pesticide Action Network et l’apiculteur indépendant membre de Nature & Progrès, Benoît Dupret, contre les dérogations belges à l’interdiction des néonicotinoïdes en Europe. Ce dossier est porté devant la Cour européenne de Justice. Nous ne pouvons plus tolérer que la Belgique déroge à tout-va. Quand l’Europe interdit une molécule, c’est qu’elle est vraiment nocive pour la santé ! La dernière dérogation accordée au Mancozeb est une honte : ce fongicide, utilisé entre autres en betteraves, a été interdit, au niveau européen, car c’est un perturbateur endocrinien toxique pour la reproduction ! Encore un fongicide autorisé depuis 1960 !
- interpeller à nouveau le ministre Clarinval au sujet des « co-formulants » des pesticides. Nous avons, là aussi, de graves inquiétudes car une étude récente a montré qu’ils sont loin d’être d’anodins compléments des substances actives. Une première demande adressée au ministre a, malheureusement, essuyé une fin de non-recevoir. Nous devons donc intervenir par d’autres moyens.
En direction de l’autorité régionale, nous allons :
- nous appuyer sur les études Expopesten et PROPULLP, de l’ISSeP, ainsi que sur le récent Biomonitoring humain wallon, qui ont montré une inquiétante dispersion des pesticides dans l’environnement wallon, afin de comprendre comment il se fait que les techniques de pulvérisation – que ce soit en agriculture ou pour l’application des traitements herbicides sur les voies de chemins de fer, ou encore pour d’autres usages – ne garantissent jamais la non-dérive des produits utilisés ;
- interpeller la Ministre wallonne de l’environnement, au sujet de l’arrêté du gouvernement qui prévoit les conditions à respecter lors de traitements à l’aide de pesticides ; nous lui demanderons que ces conditions soient revues afin d’empêcher toute dérive car rien ne justifie, à nos yeux, que des riverains aient à en supporter les conséquences ;
- réclamer que les moyens alloués à la recherche et à l’encadrement pour l’optimalisation de l’usage des pesticides soient réorientés vers la recherche et le développement des alternatives à leur usage. Les utilisateurs n’ont plus besoin de conseils pour utiliser les pesticides, ils ont plutôt besoin de conseils pour en sortir ! Il faut donc les accompagner dans le développement d’alternatives et, en ce sens, les centres de recherche et les structures d’encadrement auront l’opportunité idéale pour construire, avec eux, l’agriculture et l’alimentation de demain.
Les pesticides sont le reflet d’une vision du passé ! Osons leur tourner le dos et œuvrons, tous ensemble, au développement de leurs alternatives. Et au développement de l’agriculture biologique. Une Wallonie sans pesticides, nous y croyons !