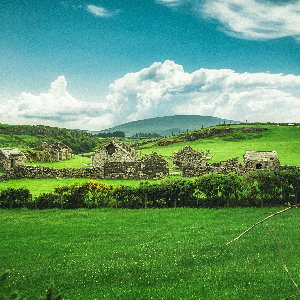9, Nov 2023 | 2023, Analyses, Études
Comment peut-on encore gaspiller l’eau potable en l’utilisant négligemment aux toilettes ou en remplissant sa piscine, quand partout la terre se craquelle ? Dans une Europe en voie d’assèchement, elle est devenue une ressource rare, forcément de plus en plus chère et… source de conflits !
Par Marc Fasol
Quelles pistes devons-nous aujourd’hui adopter pour une gestion responsable, équitable et résiliente de l’eau ? De quoi s’adapter aux effets de plus en plus préoccupants du dérèglement climatique. Ces quelques petits conseils doivent-ils être prodigués aux seuls ménages ? Ou devons-nous aussi prendre en considération l’empreinte hydrique de notre industrie ? Voire celle de notre agriculture intensive, si gourmande en eau ? Voilà ce que se propose d’examiner la présente analyse.
Les deux faces d’une même pièce
Après s’être longuement penché, à l’été 2021, sur la façon de prévenir et de contrer les inondations, voilà que l’actualité de l’été dernier nous pousse soudain vers l’autre ornière : affronter les sécheresses à répétition ! Eh bien oui, juillet 2021 et juillet 2022 évoquent à eux seuls les effets désastreux du changement climatique. Inondations record et sécheresse historique ne sont, en réalité, que les deux faces d’une seule et même pièce. Dans son 6e rapport daté du 9 août 2021, le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) annonce sans sourciller que le changement climatique est en train de se généraliser, de s’accélérer et de s’intensifier. A l’avenir, les vagues de chaleur seront plus fréquentes, plus longues, plus sévères, surtout en Europe, région où tous ces changements s’exerceront de manière deux fois plus violente qu’ailleurs. Excusez du peu.
Dans le sud de la France, le mois de juillet dernier aura été le plus sec depuis le début des relevés météorologiques. Un phénomène associé à des vagues successives de sécheresse et de pics de chaleur extrêmes, entrainant à leur tour des effets dramatiques sur la végétation forestière, vulnérable au stress hydrique avec risques accrus d’incendie à la clé, parfois incontrôlables, comme en Gironde ou en Dordogne.
En réaction à ce scénario peu réjouissant pour l’avenir de la planète, la rhétorique habituelle exige de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde est maintenant bien d’accord là-dessus, mais il faudra aussi désormais – et c’est le thème de ce dossier – pouvoir s’adapter à tous ces changements. Car ceux-ci sont, hélas, irréversibles. N’en déplaise aux sceptiques, il n’y a pas de retour attendu « à la normale » avant… quelques milliers d’années !
« Iceberg droit devant capitaine ! »
A vrai dire, les climatologues – traités jusqu’ici au mieux de grincheux ou de catastrophistes – ne s’attendaient pas à un tel coup d’accélérateur. Ils sont aujourd’hui dépassés par l’ampleur des événements. L’horizon 2030-2040 ? Il est pulvérisé ! L’augmentation du nombre de périodes de sécheresse, tant en fréquence qu’en intensité rend la question de l’eau de plus en plus préoccupante, avec – on s’en doute – des effets catastrophiques sur notre approvisionnement, sur l’ensemble des écosystèmes, sur notre agriculture et notre alimentation en particulier.
La situation est même à ce point alarmante, qu’à la COP 27 qui s’est tenue en Egypte, l’ONU nous demande de nous préparer… aux vagues de chaleur ! Depuis l’accord de Paris, l’espoir de limiter le réchauffement climatique à +1,5°C est, en effet, largement dépassé et considéré comme « hors d’atteinte ». Nous courons droit vers les +2,8°C. Un brin désabusé, Antonio Guterres, Secrétaire Général de l’Organisation, en tribun désappointé de la lutte contre la crise climatique, ne mâche pas ses mots : « Nous nous dirigeons droit vers une catastrophe mondiale« , affirme-t-il sans détours. Beaucoup de régions de la planète, touchées par les méga-sécheresses occasionnelles, risquent de devenir des zones définitivement sèches… Et donc tout simplement invivables pour l’être humain – les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Nature Reviews Earth & Environment.
Cet été, les Européens ont tiré la langue en affrontant le manque d’eau potable. Rien qu’en France, nonante-trois départements sur nonante-six ont connu des restrictions dans l’usage de l’eau dont soixante-six concernant l’eau potable. Tous les prélèvements non-prioritaires y ont été interdits : arrosages de jardins, d’espaces verts, de terrains de golf, lavage des voitures et bien sûr le remplissage des piscines… Des restrictions d’eau qui, pour l’heure, sont toujours en cours dans certaines régions.
« Quand tu portes ton propre seau d’eau, tu te rends compte de la valeur de chaque goutte… »
Et en Belgique ? Faute d’eau potable au robinet, de nombreuses communes wallonnes n’ont eu d’autre alternative que d’être approvisionnées par camions-citernes de soixante mille litres chacun. Cet automne encore, en Ardenne, ils font la navette depuis le barrage de Nisramont pour pallier le manque d’eau dans certaines zones de captage. Du jamais vu ! Un surcoût environnemental dont on se serait évidemment bien passé… Les sources seraient-elles moins bien approvisionnées que par le passé en raison d’un déficit pluviométrique ? Ou peut-être, au fil du temps, les besoins de consommation sont-ils devenus de plus en plus importants ? Les deux assurément. Selon la fédération professionnelle des opérateurs d’eau, un ménage moyen de trois personnes ne consommerait que cent quatre mètres-cubes d’eau potable par an, un chiffre qui serait même revu à la baisse, ces dernières années en raison notamment de la performance des appareils économes en eau. Bonne nouvelle donc ? Pas sûr…
Car, à notre petite consommation, s’ajoutent d’abord les pertes liées au vieillissement de notre réseau de distribution – jusqu’à 20% ! La Stratégie Intégrale Sécheresse, S.I.S., approuvée par le gouvernement wallon en juillet dernier, a notamment retenu, parmi ses nombreuses mesures, d’améliorer la performance du réseau d’eau potable en réduisant les fuites. Avec nos quarante mille kilomètres de réseau – de quoi faire le tour du globe – il y a encore du pain sur la planche !
Pour être tout-à-fait honnête, il faudrait cependant préciser que nos besoins en eau ne se limitent pas à l’écoulement du robinet de la cuisine et à celui de la salle de bain. Selon l’ONG Water FootPrint Network – www.waterfootprint.org/en/ – l’empreinte hydrique du Belge serait quand même une des plus importante au monde… si on veut bien tenir compte de nos consommations indirectes, incluant ne serait-ce que la quantité d’eau nécessaire pour faire pousser les aliments que nous mangeons et celle qu’il faut pour fabriquer les vêtements que nous portons. Les chiffres cités en la matière laissent rêveur. La fabrication d’un hamburger ? Mille litres d’eau ! Celle d’un simple jean ? Dix mille litres… Notre hyperconsommation pèse lourd sur les réserves en eau et, même si la consommation journalière du ménage belge est relativement sobre par rapport à celle des autres Européens, il en consomme malgré tout bien trop. Et il y a fort à parier qu’à l’avenir, restrictions et coupures d’eau se feront de plus en plus pressantes…
« Tirer une chasse d’eau potable sera bientôt une aberration totale, voire une hérésie »
A domicile, les principaux postes de consommation d’eau potable se trouvent aux toilettes – 31% – et à la salle de bain – 36%. Se rajoutent à cela, la consommation pour la lessive – 12% -, l’entretien – 9% – et la vaisselle – 7%. En comparaison, l’utilisation en cuisine pour l’alimentation et les boissons apparaît, somme toute, presque négligeable – 5%. De tels pourcentages laissent entrevoir l’énorme potentiel que représente, par exemple, la récupération systématique de l’eau de pluie. Au moins 60% de notre consommation domestique – salle de bain + toilettes – pourrait ainsi être facilement satisfaite, sans compter les usages en extérieur… Mais on mesure surtout pourquoi laver chaque semaine sa voiture, sa terrasse ou son trottoir, arroser copieusement ses vertes pelouses avec de l’eau potable sont devenus des gestes peu éco-responsables, de plus en plus mal vus par l’entourage, surtout quand les pluviomètres restent désespérément vides.
Au nord du pays, comme chez nos voisins néerlandais, le problème devient vraiment très préoccupant. D’année en année, en plus d’être fortement exposé aux pollutions agricoles dont sont responsables les élevages intensifs, le niveau des nappes phréatiques baisse dangereusement. Selon le World Resources Institute, la Flandre est de plus en plus exposée au manque chronique d’eau. Au niveau mondial, même la Namibie ferait mieux ! Ceci explique pourquoi la politique menée en Flandre pour valoriser l’eau de pluie est si différente de celle menée jusqu’ici en Wallonie. Elle est même diamétralement opposée !
En Wallonie, l’inquiétante sécheresse de 2022 fut visible surtout au niveau des cours d’eau historiquement bas, où la pratique du kayak et celle de la pêche furent interdites. Mais notre inquiétude n’aura été, en fin de compte, que fort limitée. Les précipitations de l’automne et de l’hiver précédents avaient été suffisamment abondantes pour permettre de recharger les nappes. C’est dans ces réservoirs souterrains naturels, situés essentiellement dans les zones calcaires, qu’est essentiellement prélevée notre eau de distribution – à raison de 79,2%.
Seules quelques dix-huit communes wallonnes, afin d’éviter tout gaspillage, ont été contraintes de prendre des mesures pour restreindre leur consommation d’eau. De leur côté, pour atténuer les effets du réchauffement sur notre approvisionnement, les hydrologues ne manquent pas d’imagination. Parmi les bonnes idées formulées dans la S.I.S., notons la lutte contre l’imperméabilisation et le soutien à l’infiltration des eaux à très grande échelle, en généralisant par exemple la plantation de haies et de bandes boisées. De telles mesures permettent aux eaux pluviales de recharger davantage les nappes phréatiques, plutôt que de s’engouffrer directement dans les caniveaux… Plutôt que de puiser sans cesse dans les nappes phréatiques, il faudrait peut-être aussi penser à réutiliser les eaux usées. Une fois épurées, elles pourraient très bien servir à l’irrigation des cultures…
En ville, où le moindre mètre carré est asphalté et bétonné, il serait judicieux de créer des trames bleues et vertes en périphérie. Quant aux particuliers, il serait bon de doter chacune de leur habitation d’une grande citerne d’eau de pluie…
« Chacun tire l’eau à son moulin »
Généraliser la récupération de l’eau de pluie est une réponse particulièrement intéressante à développer, d’autant qu’à l’instar des autres mesures énumérées ci-dessus, elle atténue également les pics d’écoulement lors de fortes pluies, surtout en ville. Par effet tampon, cet effort de récupération sera de nature à éviter le débordement des égouts et celui des stations d’épuration, tout en diminuant indirectement les risques de débordement des rivières. Les deux phénomènes, sécheresses et inondations, sont ainsi définitivement liés. Hormis sa précieuse gratuité, ce don de la nature qu’est l’eau pluviale présente encore de nombreux autres avantages d’un simple point de vue domestique. Exempte de calcaire, elle prolonge notamment le fonctionnement des appareils ménagers : machines à laver, machines à café, bouilloires, conduites d’eau, robinetterie et pommeaux de douche… Très douce, l’eau de pluie est idéale aussi bien pour laver le linge que la vaisselle. Plus besoin par conséquent d’adoucisseur, de produits anticalcaires ou de détartrage, sans compter l’économie substantielle en savons divers et détergents non ou peu biodégradables.
« Et contrairement à ce qu’on peut lire sur les fiches pratiques publiées par Aquawal, relève Eric Simons, de la société Airwatec, spécialisée en filtration et traitement des eaux, l’eau de pluie n’est pas mauvaise pour la peau. Tant qu’elle n’a pas atteint le sol, celle-ci est de très très bonne qualité. » On a longtemps jeté systématiquement le discrédit sur l’eau de pluie – tiens, tiens, ce qui est gratuit serait-il forcément moins bon ? – mais une fois filtrée, sa qualité est vraiment remarquable : pas de chlore, pas de nitrates, pas de résidus de pesticides…
« En revanche, de plus en plus de produits chimiques se retrouvent dans les nappes phréatiques dont la qualité n’arrête pas de se détériorer. La situation n’est plus la même que dans les années soixante et évolue sans cesse, souligne encore Eric Simons, aujourd’hui des traces d’antibiotiques et de perturbateurs endocriniens par exemple s’y retrouvent. Or, il n’existe aucune méthode, aucune membrane d’osmose pour s’en débarrasser ! »
En France, d’après le journal Le Monde, des substances issues de la dégradation des pesticides épandus durant des décennies sur les terres agricoles, ont fini par percoler jusque dans les nappes phréatiques. Ces produits – parfois entre-temps interdits à la vente et/ou à l’usage – se sont fragmentés et recombinés en nouvelles molécules, connues désormais sous le nom de métabolites. On estime à présent, que douze millions de personnes auraient au moins épisodiquement consommé une eau « non conforme », polluée par ces substances aux noms barbares. Parmi elles, le chloridazone desphényl dérivé d’un herbicide utilisé dans la culture de betteraves. Avec des concentrations maximales régulièrement dépassées, le principe de précaution aurait dû être appliqué. Un prochain scandale sanitaire en suspens ? Voilà qui en dit long en tout cas sur l’étendue de la contamination de nos ressources en eau par les pesticides mais aussi sur les lacunes dans la surveillance de la qualité de l’eau potable – jusqu’ici, la plupart de ces substances dont la toxicité reste inconnue ne sont tout simplement pas recherchées -, sans parler du désarroi de nos élus et des autorités sanitaires contraints d’imaginer, en urgence, de nouvelles normes moins restrictives pour éviter de devoir interdire la consommation d’eau de distribution dans certaines régions…
Aujourd’hui, pour des raisons écologiques mais pas seulement, un nombre croissant de consommateurs se tournent vers l’eau de pluie et optent pour le placement d’une citerne afin de satisfaire au moins une partie de leurs besoins domestiques. Obligatoires en Flandre et à Bruxelles lors de la construction, les nouvelles habitations en sont désormais systématiquement équipées. En Wallonie, il n’a pas semblé nécessaire au législateur de les imposer car de nombreux constructeurs s’en sont équipés spontanément, soit par souci de rentabilité, soit parce que les autorités communales, en particulier celles qui sont régulièrement en déficit hydrique, conditionnent simplement l’installation d’une citerne au permis d’urbanisme, tandis que parfois, d’intéressantes primes sont octroyées…
Reste cependant un problème de taille : si l’eau de distribution est un des produits alimentaires les plus contrôlés – trente mille analyses par an -, par des prélèvements opérés sur les lieux de captage ou directement au robinet du consommateur, en passant par les zones de stockage – d’après la Société Publique de Gestion des Eaux (SPGE), les normes de qualité sont même supérieures aux exigences légales -, il n’y a évidemment guère de garanties apportées pour les eaux dites « alternatives », à savoir l’eau de pluie, l’eau de puits et l’eau de source. Chargée de micro-organismes – virus, bactéries – et de différentes matières en suspension lors de son parcours – toit, gouttière, citerne -, l’eau de pluie est impropre à la consommation en tant que telle. Quant aux eaux de puits ou de source, après avoir ruisselé sur les terres agricoles, elles peuvent malheureusement être chargées en nitrates et en résidus de pesticides. Pour des raisons sanitaires évidentes, ces eaux pourraient donc, en principe, n’être destinées que pour l’usage externe sans risques sanitaires : le jardin, la serre, l’entretien du logement, le lavage de la voiture, à la buanderie ou encore aux toilettes.
« Creusez un puits avant d’avoir soif »
Précisons encore que si les propriétaires de citernes d’eau de pluie ne doivent pas les déclarer, ceux des puits sont soumis à d’autres obligations : couvercles fermés à clef, compteurs volumétriques, taxes pour le rejet d’eaux usées, etc. Quant au forage, la tâche doit être exécutée par un professionnel agréé et, cette fois, c’est le permis d’environnement qui est requis. Dans tous ces cas de figure, afin d’éviter toute contamination du réseau publique d’eau potable par une eau qui ne le serait pas, Aquawal a tout prévu. À l’intérieur de l’habitation, c’est le « Code de l’eau » qui s’applique, en reprenant les règles à respecter. Toute connexion physique entre le réseau de distribution et autre « réseau alternatif » est interdite, notamment par un jeu de vannes ou de clapets anti-retour. Ces réseaux doivent donc faire l’objet de raccordements distincts.
Comme la potabilité de l’eau recueillie à la sortie des gouttières peut être mise en doute, le particulier se voit généralement contraint a priori de ne valoriser son eau de pluie qu’à la buanderie, au garage ou au jardin. Même limité uniquement à l’usage des toilettes – ce qui représente quand même un tiers de la consommation d’un ménage -, l’utilisation de l’eau de pluie représente déjà une jolie économie. Fort heureusement, il existe des dispositifs compacts et relativement bon marché pour traiter l’eau, ce qui permet d’élargir davantage le champ des applications, le tout avec une sécurité accrue d’utilisation. Le kit Cintropur TRIO-UV triple action – filtration des particules, traitement par charbon actif et stérilisation UV – que nous avons testé, assure par exemple un traitement intégral particulièrement intéressant. Extraite de la citerne par une aspiration flottante, le traitement de l’eau se fait, dans un premier temps, par filtration mécanique à l’aide d’une « chaussette » – un tamis de 25μ -, afin de retenir les particules les plus fines. L’eau est ensuite traitée au charbon actif à base de noix de coco, puis est finalement stérilisée par rayonnement ultra-violet. L’eau de pluie peut alors être valorisée à hauteur de 95%, et être utilisée en toute sécurité, pour toutes les applications sanitaires de la maison : lave-vaisselle, lave-linge – sept mètres cubes par an -, bains, douches, lavabos, jacuzzis… Et même la piscine – soixante mètres cubes ! -, ces piscines dont les ventes ont littéralement explosé avec la succession d’étés caniculaires. Le serpent est en train de se mordre la queue !
Contrairement aux processus chimiques de désinfection par l’ajout de chlore, la stérilisation par rayonnement ultra-violet est un moyen physique germicide, sans risque de surdosage et sans sous-produits toxiques. Durant le passage de l’eau, les bactéries, les virus et les protozoaires sont neutralisés. L’eau de récupération débarrassée de son goût et de ses odeurs désagréables de citerne devient pure bactériologiquement. Notons cependant que cette eau n’est toujours pas considérée comme 100% potable tant que les paramètres chimiques n’auront pas, eux aussi, été vérifiés et jugés satisfaisants.
Ainsi, écologie rime-t-elle aussi avec économie pour le budget du ménage. Mais ceux qui n’ont pas envie de se lancer dans une telle entreprise, peuvent déjà commencer par une utilisation minimale de l’eau de pluie au jardin, le plus simple consistant, par exemple, à raccorder, sur la terrasse, une descente de gouttière à une cuve ou à un tonneau, via un collecteur à filtre WISY qui envoie à l’égout feuilles, mousses et invertébrés indésirables. L’appoint en eau propre est tout sauf négligeable. Les récipients de mille, voire deux mille litres, sont peu onéreux et aisément disponibles en jardineries…
Des citernes et des primes : nos meilleurs « tuyaux »…
Pour ce qui est du stockage, il existe plusieurs types de citernes. Les modèles aériens en polyéthylène, imputrescibles et résistants au gel, montent jusqu’à dix mille litres. Certains peuvent aussi être enterrés et même jumelés. Hélas, ces derniers sont assez onéreux : trois mille cinq cents euros pièce, hors travaux de terrassement… La formule idéale semble plutôt être la dépose dans le sol, lors de travaux de construction ou de restauration, de citernes en béton de dix mille voire vingt mille litres… Budget : deux mille cinq cents euros, hors terrassement. L’investissement est donc relativement vite amorti. Avec les citernes en béton, l’acidité de l’eau stockée est en plus rapidement neutralisée. Notons aussi que la plupart des gens qui recourent à l’eau de pluie regrettent généralement de ne pas avoir opté, dès le départ, pour une citerne de plus grande capacité…
Pour récupérer l’eau de pluie, mieux vaut encore que le toit soit pentu et recouvert de tuiles car la superficie de captage est plus grande. Les toits plats couverts de membranes collées à chaud, ne sont pas adaptés à la récupération de l’eau de pluie ; ils exhalent une odeur de goudron. En période de canicule, les algues ont tendance aussi à y proliférer et à boucher les filtres. En Wallonie, la pluviosité est variable d’une région à l’autre, mais la moyenne est d’environ huit cent cinquante millimètres par an, soit huit cent cinquante litres par mètre carré. Pour récupérer entre quarante-cinq et nonante mètres cubes par an, la superficie totale du toit devrait idéalement être comprise entre cinquante et cent mètres carrés en projection horizontale.
Aujourd’hui, tous les nouveaux raccordements à l’eau de distribution entrainent obligatoirement la visite d’un certificateur agréé pour l’obtention du CertIBEau. Ce certificat garantit la conformité des installations au « Code de l’eau » : sécurité sanitaire des installations intérieures en eau potable et préservation de l’environnement pour les rejets d’eaux usées.
Le prix approximatif d’une pompe auto-amorçante WILO, de type MC305, pour récupération de l’eau de pluie est de 640,- euros, celui d’un kit de filtration Cintropur TRIO UV est de 720,-€. Le prix moyen TVA incluse de l’eau de distribution incluant le « Coût Vérité de la Distribution » (CVD) et le « Coût Vérité de l’Assainissement » (CVA) avoisine actuellement les six euros le mètre cube ; il avait doublé, entre 2004 et 2014, mais voilà qu’après une période de stabilisation, celui-ci repart de nouveau à la hausse…
En Région bruxelloise, il existe des primes à l’installation de citernes d’eau de pluie. De cent à… mille sept cents euros, à Saint-Josse notamment, selon certaines conditions liées en particulier aux revenus des intéressés. Côté Région wallonne, pas de primes à attendre… sauf dans certaines communes. Pour leur installation ou leur rénovation, les communes de Burdinne, Donceel, Remicourt, Stoumont, Thimister et Wasseiges, Namur, Somme-Leuze, Rochefort, Braine l’Alleud, Plombières, Fauvillers, Libramont et Vielsalm, remboursent jusqu’à cinq cents euros.
Agriculture : à quand la Transition durable ?
Alors que partout les besoins en eau explosent, l’ONU estime que mondialement, ils devraient encore augmenter de 90% d’ici 2050 – par rapport à 2017. Le déficit menace désormais un quart de la population mondiale, régulièrement sujette à un stress hydrique extrême. Parmi les différentes grosses consommations d’eau, on trouve bien sûr les besoins directs liés à la consommation domestique, notamment dans les grandes villes – 8% -, elles-mêmes étroitement tributaires de la croissance démographique : nous sommes, depuis mi-novembre, huit milliards d’êtres humains. Mais il y a aussi les besoins indirects comme ceux liés à l’industrie – 22% -, ainsi que le secteur de la production d’énergie, son corollaire. Pourtant c’est surtout le secteur agricole qui doit retenir nos préoccupations. Dans le monde, 70% de la consommation d’eau est destinée à l’irrigation des cultures.
Comment adapter durablement cette énorme consommation aux conséquences des grands bouleversements climatiques qui s’annoncent, tout en répondant efficacement à des besoins alimentaires planétaires toujours en croissance ?
De nombreux éléments de réponse sont déjà bien connus. Aussi ne ferons-nous ici que les ébaucher. Dans les pays émergents, ce sont désormais les nouveaux modes de consommation alimentaire qui se taillent la part du lion. Les populations, autrefois peu développées, mangent de nos jours davantage de viandes et de laitages. Or pour produire un seul kilo de viande de bœuf, il faut… quinze mille cinq cents litres d’eau ! Un régime alimentaire clairement intenable s’il fallait l’étendre à huit milliards d’habitants.
Chez nous, la fabrication de biocarburants cristallise, à elle seule, toute l’absurdité de notre société de consommation : la fabrication d’une tonne équivalent pétrole – 1tep – d’éthanol à partir de maïs nécessite… un quart de million de litres d’eau ! La même tep de biodiesel à partir de soya nécessite cent soixante mille litres. C’est donc bien notre mode de vie gourmand en ressources et notre hyperconsommation compulsive qui – a fortiori si elles sont exportées dans le sud – pèsent le plus sur les réserves d’eau de la planète.
Depuis quelques années déjà, nos cultures se heurtent à l’irrégularité et à l’imprévisibilité des précipitations, tandis que les périodes de sécheresse ne cessent de se prolonger. Entre le moment où les agriculteurs ont besoin d’eau et le moment où elle tombe du ciel, le décalage peut être fatal aux cultures. Et comme il fait de plus en plus chaud, irriguer les cultures demande davantage d’eau dont une partie toujours plus importante s’évapore. Il ne s’agit plus de simples caprices de la météo, mais bien de transformations profondes d’un climat qui déstabilisent structurellement les pratiques : « l’avenir n’est plus écrit par le passé ». Sont évidemment montrées du doigt, les cultures très gourmandes en eau, comme les immenses champs de maïs, qui sont aussi les plus fragiles. Avec toutes les conséquences que cela implique principalement sur l’élevage…
En France, des manifestations, parfois violentes, voient le jour : depuis les sécheresses, l’accaparement de l’eau devient une source majeure de conflits. Certains parlent carrément de « guerre de l’eau ». Les méga-bassines, installées par des agriculteurs – dans les Deux-Sèvres notamment -, au mépris des réalités hydrologiques, sont prises à partie, les opposants invoquant la confiscation, au seul profit de quelques-uns, d’une ressource vitale, d’un bien commun. Désormais, les conflits qui concernaient seulement les cultures, touchent aussi les terrains de golf, les terrains de foot, les piscines, les jacuzzis, les pelouses, les parcs publics…
Une précieuse ressource qui subit de plein fouet le changement climatique !
Une première conclusion semble s’imposer afin d’anticiper des conflits qui risquent de dégénérer rapidement : il est indispensable de réduire nos consommations et de mettre en place une gestion équitable de cette ressource fragile et limitée qu’est l’eau. Mais comment faire ? Voici quelques pistes souvent évoquées ; nous laisserons, quant à nous, le soin aux gens de terrain de les investiguer plus en profondeur et d’en débattre sereinement :
– augmenter l’offre par davantage de pompages souterrains et de déviations de rivières ? Irriguer davantage, alors que le thermomètre s’affole, ne saurait résoudre toutes les difficultés auxquelles est confrontée l’agriculture. Les risques d’évaporation et d’assèchement, de dérèglement de systèmes hydriques complexes compenseront sans doute bien mal notre manque de résilience agricole face aux extrêmes climatiques…
– modifier nos consommations en limitant, par exemple, drastiquement les produits de l’élevage ;
– modifier les périodes de semis et de récoltes afin de mieux adapter les choix de cultures à l’évolution générale du climat et singulièrement des températures saisonnières…
– introduire de nouvelles cultures mieux adaptées au dessèchement des sols. Le sorgho serait-il apte, par exemple, à remplacer les cultures de maïs pour l’alimentation animale ?
– tabler davantage sur les enseignements de l’agroécologie, en introduisant davantage de biodiversité au sein de nos cultures afin de mieux lutter contre les maladies et les ravageurs ?
– pratiquer des semis sur sols non labourés et opter résolument pour un couvert végétal permanent afin de limiter le ruissellement des eaux, au moment de la saison sèche ?
Le débat a commencé, l’urgence est là…
15, Déc 2022 | 2022, Analyses, Études
« Les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité et ne voient la nécessité que dans la crise… » Jean Monnet
Introduction / contextualisation
Par Dominique Parizel
En crise, incontestablement, nous le sommes, personne ne semble plus vouloir s’obstiner à contester cela. Nous n’avons même que l’embarras du choix : guerre en Ukraine accentuant la crise énergétique – même si aucune pénurie ne semble encore à craindre -, crise sanitaire – nous en sortons, ou presque ? -, crise politique – les populismes sont là et bien plus près de nous qu’on ne veut souvent l’admettre -, crise économique – bonjour l’inflation ! -, crise climatique, crise de la biodiversité, crise agricole, crise de foie (après les Fêtes)… Nous vivons tellement de crises – sans voir en quoi elles sont éventuellement complémentaires, en quoi ce sont éventuellement les mêmes… – qu’au fond, elles nous indiffèrent dans le cadre douillet de nos comportements quotidiens, elles ne semblent jamais devoir nous imposer d’amener quoi que ce soit de différent dans nos vies. Sauf quand, par le plus grand des malheurs, soudain la fatalité nous frappe !
Cette fatalité, cette terrible incertitude, cette grande injustice qui perpétuellement nous menace, cette impossibilité d’imaginer autre chose que ce que nous sommes et d’être autre chose que ce que nous vivons jour après jour, est une incommensurable source d’angoisse pour nos concitoyens. Beaucoup d’entre nous la nient et se drapent dans l’indépassable nécessité de ce qu’ils font, de ce qu’ils ont toujours fait. L’économie doit tourner, j’ai besoin de ma voiture pour aller travailler, je râle abominablement quand je suis dans l’embouteillage, je n’admets jamais que je suis moi-même une part significative de cet embouteillage ! La chose qui m’étreint ne trouve pas de solution. Le serpent se mord la queue. Le cancer me ronge. Mais comment pourrait-il en être autrement, les mêmes causes produisant immanquablement les mêmes effets et leur accumulation les amplifiant et les démultipliant ?
Les plus conservateurs se rassurent en mettant juste quelques emplâtres sur la jambe de bois : la magnifique Tesla électrique ne me privera pas de ma rutilante limousine où je roule seul et trop vite, la prolongation du nucléaire me donnera l’énergie pour produire les objets inutiles qui finissent à l’incinérateur mais m’enrichissent au passage, la conviction qu’il est possible de limiter l’utilisation des pesticides ne remettra jamais en question le modèle agricole qui déglingue les sols et la planète… Nous en sommes pas des bœufs, n’est-ce pas ? Le carbone, nous le stockerons, coûte que coûte, manu militari s’il le faut. Nous avons notre standing à conserver. MAGA, hurle Trump !
D’autre admettent la nécessité de se préparer mais sans savoir exactement à quoi. Ils appellent cela la « résilience » et on en parle beaucoup. Issu de l’anglais, ce terme fut d’abord employé en physique des matériaux, désignant leur capacité à absorber de l’énergie, à résister à un choc. Soit ça passe – et ça plie ! -, soit ça casse mais il est évidemment très intéressant de savoir jusqu’où ça peut tenir et pourquoi… Dans le domaine de la psychologie, Boris Cyrulnik popularisa ce terme, en France, signifiant – pour faire simple – la capacité d’un individu à surmonter les traumatismes, l’aptitude à continuer une vie satisfaisante en dépit de circonstances, d’événements qui soudain la bouleversent. Pour ce qui nous concerne, en matière environnementale, le terme s’emploie pour les écosystèmes ou les biotopes, ou toujours les individus, afin d’exprimer leur potentiel à se rétablir, après qu’un événement extérieur en a perturbé le fonctionnement ordinaire. Ce potentiel inespéré qui permet de continuer à vivre, par exemple, après un tremblement de terre, des inondations, une sécheresse intense… Toutes ces catastrophes qu’on nous annonce aujourd’hui bien plus fréquentes et qui peuvent être, entre autres, attribuées au dérèglement du climat…
Question essentielle, par conséquent : qu’est-ce qui peut contribuer à nous rendre plus résilients, individuellement et collectivement ? C’est évidemment très difficile à dire… La résilience tient autant de la prévoyance bien ordonnée – au sens où le comprennent, par exemple, les Femmes prévoyantes socialistes – que de l’instinct de survie – ce qui nous reste lorsque nous ne pouvons plus fuir, lutter ou nous replier sur nous-mêmes… Longtemps, Nature & Progrès s’est efforcé d’imaginer – dans la droite ligne d’une bio qui devait pallier aux dérives de l’agriculture chimique -, l’ensemble des comportements citoyens qui pourraient s’avérer salutaires en cas de « gros pépin » engendré par un progrès mal pensé. Pendant très longtemps, aux yeux des écologistes, le symbole même de ce « gros pépin » fut l’accident nucléaire. Que pouvait-on bien trouver afin d’être à même de survivre – physiquement et symboliquement – à un effondrement de ce genre ? Les plus anciens se souviennent de séries de BD comme Simon du fleuve, d’autres lisent encore Jeremiah… Voilà, en gros, ce que nous décrivons dans la première partie de cette étude, où nous essayons de faire le point sur bon nombre d’attitudes, certes rassurantes, mais qui n’ont qu’une puissance limitée de sauvegarde, eu égard à la grande diversité de situations qu’une résilience bien pensée devrait être aujourd’hui en mesure d’anticiper. Qu’on se rassure toutefois : si certaines propositions, peut-être, prêteront à sourire, toutes ne tiennent pas du pur fantasme – certaines sont même tout simplement ce que faisaient nos chers aïeux pour préparer l’arrivée de l’hiver ! D’autres nous prennent de vitesse : en témoigne l’initiative allemande – les Allemands sont bien connus pour être des gens prévoyants et organisés ! – de proposer gratuitement à la population une brochure poétiquement intitulée « Katastrophen Alarm » et qui n’a pas, bien sûr, son équivalent dans la Belgique incrédule où rien de fâcheux – voyons, vous n’y pensez pas ? – ne peut jamais se produire… Son but est simplement de fournir à la population quelques éléments de solutions concrets et réfléchis, au cas où surviendrait inopinément un problème grave.
Car des problèmes graves, de plus incontestablement liés à l’état du climat, nous commençons à en croquer ! Ils surviennent évidemment là où nous ne les attendions pas, comme la tartine qui tombe toujours sur la moquette du côté de la confiture. Rassuré qu’il était, entre sa mer du Nord et l’or bleu de ses Ardennes, le Belge moyen n’aurait jamais imaginé devoir se poser la question qui donne son titre à la seconde partie de la présente étude : « Et si l’or bleu venait à manquer ? » Que l’été 2021 fut marqué, en Wallonie, par des inondations particulièrement dramatiques rend, en effet, d’autant plus incroyable le fait que notre région ait connu, l’année d’après, un des pires épisodes de sécheresse de son histoire… Nous étions pourtant avertis : la crise climatique se traduirait, dans nos régions, par une alternance de précipitations intenses et de moments caniculaires. Etions-nous prêts ? Certainement pas. Quelles leçons tirons-nous, individuellement et collectivement ? C’est ce que nous allons tenter d’apercevoir, en prodiguant, au passage, l’un de nos conseils les plus anciens et les plus précieux : et si nous conservions jalousement, dans des citernes domestiques, le peu d’eau de pluie qui nous tombe encore sur la tête ? Notre bonne vieille « drache nationale » sera-t-elle une composante essentielle de notre résilience ? Il ne tient vraiment qu’à nous d’y songer sérieusement…
1ere partie
« Se préparer au pire ! »
Financière, climatique, énergétique, sanitaire… Les crises sociétales se multiplient mais, par effet domino, elles s’aggravent aussi l’une l’autre. En butte à une précarité grandissante et généralisée sur fond d’effondrement(s) (1), il est indispensable pour tout citoyen de gagner en résilience, en autonomie, de sortir de sa « zone de confort » et d’anticiper les catastrophes qui s’annoncent. Plus le temps de se faire peur donc. Voici le Plan B face aux pénuries…
Les catastrophes naturelles de ces deux dernières années sont inédites, brutales et d’une ampleur jamais vue auparavant. Outre les pertes humaines à déplorer, les dégâts matériels « astronomiques » grèvent progressivement les dettes de l’Etat : cinq milliards d’euros rien que pour les récentes inondations en Wallonie. Qui avait vu l’iceberg arriver ? Même les très prudentes compagnies d’assurance semblent avoir été prises de court. Que dire alors de la crise de la Covid-19 et de son interminable cortège de promesses suivies d’autant de rebondissements, d’improvisations, de tergiversations, voire de mesures contradictoires ? « Gouverner, c’est prévoir », dit l’adage. Certes, nos dirigeants politiques font ce qu’ils peuvent, essayant de trouver un juste équilibre entre l’avis parfois radical des « experts » et la gestion socio-économique du pays. Mais force est de constater qu’aujourd’hui, dépassés, ceux-ci semblent de plus en plus réduits à subir les événements dramatiques qu’à les anticiper.
En cas de catastrophe majeure, il existe en Belgique un service de secours fédéral pour venir en aide à la population : la Protection civile. Ses effectifs, récemment revus à la baisse (!), sont répartis dans deux unités opérationnelles : Crisnée et Brasschaat. Leurs équipes spécialisées sont là pour venir en appui aux forces de police, de pompiers ainsi que des autorités communales et provinciales.
—-
La Protection civile belge
Le sigle de la Protection civile belge est facilement reconnaissable : un triangle bleu au centre d’un cercle orange. Le triangle bleu représente l’équilibre – cette couleur symbolisant la sécurité et la protection – et le cercle orange le chaos et de détresse. Si vous possédez un SmartPhone, téléchargez l’application 112 BE. Elle présente plusieurs avantages par rapport à un simple appel aux numéros 112 ou 101 :
1. Vous ne devez plus mémoriser les numéros d’urgence et vous ne risquez donc plus de les oublier si vous êtes en proie à la panique ;
2. Grâce à cette application, les services de secours peuvent vous localiser plus facilement. En effet, l’application transmet votre position à la centrale d’urgence avec laquelle vous êtes en communication, et l’actualise toutes les trente secondes ;
3. A condition de les avoir enregistrées au préalable, dès l’instant où il prend votre appel, l’opérateur dispose de certaines informations médicales sans que vous ne deviez les lui donner. Un problème de mobilité – moins valides -, un souci cardiaque, vous êtes sujet à certaines allergies – médicaments -, épileptique, diabétique… Il peut ainsi les transmettre plus rapidement aux services de secours qui viennent vous sauver.
Appeler avec l’application 112 BE est entièrement gratuit… mais ne fonctionne évidemment qu’en Belgique !
—-
Hélas, déployer les grands moyens, aussi efficaces soient-ils, ne s’avère pas toujours suffisant, en cas de force majeure. Tout le monde aura pu amèrement en faire le constat lors des dernières inondations. En pareil cas de figure, les services de secours – pouvant difficilement être présents partout en même temps ! – ont été complètement débordés. Le plus important reste finalement de pouvoir compter essentiellement sur soi-même. La solution développée dans ce dossier est d’inciter tout un chacun à préparer consciencieusement et surtout bien à l’avance, son « plan d’urgence » à domicile. Une fois qu’une crise majeure survient – inondation catastrophique, méga-feu, accident nucléaire, etc. -, il est trop tard pour commencer à prendre ses précautions…
Surabondance rime avec insouciance
En Allemagne, pays fortement touché par les inondations catastrophiques – un euphémisme -, le gouvernement a très bien compris l’intérêt d’anticiper ce genre de situation afin d’adoucir la détresse et la souffrance des citoyens. Une brochure intitulée « Katastrophen Alarm » (2), disponible gratuitement, a été éditée à cet effet et distribuée à la population. Une première qui n’a, à notre connaissance, pas encore son équivalent en Belgique. Elle propose des éléments de solutions, simples, concrets et réfléchis. Le message, un brin glaçant, est on ne peut plus clair : « dorénavant, chaque ménage doit se préparer au pire »…
A propos, qu’entend-t-on exactement par résilience ? C’est la faculté à se remettre d’un traumatisme qu’il soit psychologique ou physique. Puisque les futures catastrophes climatiques sont désormais inévitables et que celles-ci s’ajoutent à toutes celles que nous redoutions déjà, il n’est pas encore trop tard mais il est grand temps de s’y préparer sérieusement. Sortons la tête du sable !
Avec leurs rayons de vivres réassortis en permanence, les supermarchés ont fini par accoutumer les consommateurs à la surabondance. Contrairement à toutes les générations qui nous ont précédés, nous avons appris à ne pas nous préoccuper du lendemain. Trois générations ont passé, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une époque où nos (arrière-)grands-mères remplissaient avec hantise leurs placards de réserves de nourriture dans l’attente du prochain conflit – en moyenne un tous les quarante ans ! Provoquant souvent la risée des jeunes générations nées au cours des Trente Glorieuses, ces femmes prévoyantes et sages avaient pourtant tellement raison…
Eviter les achats-panique !
Dans la foulée de la crise sanitaire, sont apparues les premières pénuries, un phénomène que nous n’avions jamais connu auparavant. Bois, acier, papier et autres matières premières ont commencé à manquer un peu partout, plombant les productions industrielles. La pénurie de micro-processeurs, par exemple, ces minuscules pièces d’un centimètre carré, a mis partout les chaînes de production à l’arrêt, notamment dans le secteur automobile. Du coup, les délais de livraison se sont allongés, les prix ont flambé, tandis que le manque de containers, l’engorgement des ports, l’explosion du prix du fret maritime, du prix de l’énergie en général, le manque de transporteurs, la mise en quarantaine des travailleurs… ont encore aggravé la situation.
A tous ces problèmes de logistique, parfois très complexes pour les entreprises, s’est encore ajouté le flux des marchandises aujourd’hui tendu à l’extrême. Le just in time est une politique commerciale qui repose sur les prévisions de la demande et la minimisation des stocks. Hélas, il augmente fortement les risques de rupture d’approvisionnement en cas de crise. Or celles de la Covid-19 et du Brexit sont venus tout bousculer de manière totalement imprévue, semant la pagaille un peu partout dans le monde.
Certes, tous ces retards ralentissent la reprise économique. Mais est-ce là le point le plus préoccupant ? Que se passerait-il si, pour une raison ou pour une autre, le problème d’approvisionnement devait s’étendre au secteur alimentaire ? A l’annonce du premier confinement, on se souviendra encore longtemps chez nous de ces frénésies d’achat pour… de simples rouleaux de papier hygiénique !
Ridicule, le phénomène est pourtant bien connu sous le nom de « prophétie auto-réalisatrice » : la peur du manque qui, ceci étant dit, semble inscrite dans nos gènes, entraîne souvent la pénurie alors qu’au départ, elle n’était que virtuelle. Des mouvements de panique semblables ont été vécus, en mars 2020, aux Etats-Unis, avec une ruée sur les stocks de nourriture disponibles. Chez nous, lait, beurre, blé, pâtes, concentré de tomates, etc. avaient déjà commencé à manquer au début de la crise de la Covid-19. Il ne faut pas grand-chose pour que les rayons des magasins se vident… quand ils ne sont pas dévalisés ! La surabondance affichée par la grande distribution n’est, en fait, qu’une vaste illusion commerciale. Mieux vaut ne pas s’y fier et miser davantage sur l’autonomie alimentaire. C’est justement là que réside le cœur de notre Plan B…
« Je te survivrai » (3) ?
Ce genre de scénario catastrophe, aux effets relativement limités jusqu’ici, risque de devenir de plus en plus fréquent, pour ne pas dire de plus en plus sévère. Si seulement il pouvait servir d’avertissement, d’occasion pour expérimenter la transition, un changement en profondeur de notre société d’insouciance… A commencer par la redécouverte d’autres pistes de comportements, dans la droite ligne du bon sens élémentaire de nos ancêtres : autoproduction, apprentissage et transmission des savoirs et des savoir-faire d’antan, prévoyance, débrouillardise, sobriété, partage, réseaux de solidarité, recyclage systématique, etc.
Oubliez les gros clichés sur les survivalistes nord-américains, la kalachnikov en bandoulière (4), ou sur ces milliardaires qui se font construire des bunkers postapocalyptiques. Il ne s’agit pas ici de céder aux délires catastrophistes mais simplement de se tenir prêt. On les appelle les Preppers. Ce ne sont pas des gens paranoïaques mais des citoyens lucides qui se préparent à affronter la fin de notre société thermo-industrielle, telle qu’on l’a connue jusqu’ici. Pas la fin du monde – ce grand mythe biblique – comme on l’entend parfois mais juste la fin d’un monde, de notre monde. Sacrée nuance !
Comment s’y préparer ? Plus une société est complexe, plus elle est fragile et donc vulnérable. Une simple coupure d’électricité, une rupture du réseau Internet ou une interruption dans l’acheminement de carburants peut rendre toutes les choses de la vie, même les plus simples, extrêmement compliquées, surtout si de tels ennuis se prolongent. Nous sommes bel et bien entrés dans l’ère de l’extrême dépendance. L’Etat-providence sera-t-il toujours à nos côtés pour nous porter assistance et satisfaire nos – énormes – besoins ? « Aujourd’hui, on ne peut plus se contenter d’être assistés ou de lui confier la responsabilité d’être résilient, explique Joël Schuermans, rédac’ chef du magazine Survival, il faut pouvoir compter essentiellement sur soi-même, anticiper les problèmes et trouver des solutions… »
Stockage, de la cave au cellier ?
Pour anticiper une catastrophe de grande ampleur, la chose la plus élémentaire consiste à jouer les hamsters : assurer ses réserves de nourriture. A la maison, la pièce qui s’y prête le mieux reste la cave. Les maisons anciennes ont généralement l’avantage d’avoir été bien mieux conçues que celles d’aujourd’hui. Autonomes et dépourvues de frigidaire à l’époque, elles recelaient de pièces de stockage destinées à la conservation de toutes sortes d’aliments…
Une cave se doit d’être sèche, obscure et fraîche. Quitte à ressembler à « une petite épicerie » aux yeux des sceptiques, un foyer doté de telles réserves permet de rester serein en cas de crise aiguë et, le cas échéant, de rassurer les membres de sa famille ou de ses proches. Bien avant de songer à se garder de bons petits plats, ce sont les réserves de boissons – non alcoolisées ! – qui s’avèrent les plus indispensables à la survie. De fait, s’il est possible de tenir trois semaines sans manger, un être humain ne tient pas plus de trois jours sans boire ! Aussi, faut-il tabler sur environ quatorze litres d’eau potable – ou potabilisée – par personne et par semaine. Mieux encore, pour ceux qui disposent d’un jardin fruitier, faire presser ses fruits et en stériliser le jus afin de constituer une belle réserve. Pas cher et très salutaire !
Les adeptes de stages de survie se donnent comme objectif de pouvoir tenir six mois, voire un an, avant de sortir de chez eux. Plus modeste, une réserve de victuailles bien pensée devrait permettre à un simple ménage de tenir au minimum deux semaines, le temps que les échoppes puissent se réapprovisionner normalement.
En temps normal, les réserves stockées en cave « tournent » tout le temps : on prend le pli d’alimenter le fond des étagères et on se sert par devant. Le remplacement se fait au fur et à mesure, pensez donc à dater soigneusement les bocaux maison ! Ne comptez pas trop sur le frigidaire ou sur le surgélateur. En cas de panne de courant généralisée et prolongée, à moins d’être équipé de panneaux solaires et de batteries domestiques, les énormes électroménagers auxquels nous sommes si habitués, ne vous seront d’aucun secours. Pire, une fois décongelées, les vivres devront être consommées tout de suite, sans pouvoir être recongelées…
L’idéal reste, bien sûr, d’habiter à proximité d’un agriculteur bio ayant une ferme en polyculture-élevage – voir évidemment la liste des producteurs labellisés Nature & Progrès publiée dans Valériane n°151 – et qui commercialise ses produits en circuit court. A moins, bien sûr, que nous ne subissions une pollution chimique ou nucléaire, la grippe aviaire ou la peste porcine, et j’en passe et des meilleures…
Quelques exemples de provisions indispensables
Emballés hermétiquement – attention aux rongeurs ! – et soigneusement rangés sur les étagères, s’empilent les traditionnels paquets de pâtes. Très nutritives, on peut y ajouter les sachets de lentilles. Pensez aux bocaux de conserve maison réalisés par lactofermentation avec les légumes du potager (5) : pois chiches, haricots, carottes… Ajoutons à cela quelques terrines maison, un échantillonnage de plats préparés en bocaux – ratatouille, blanquette de veau, choucroute, soupes… -, le tout complété par diverses conserves assez classiques disponibles dans le commerce. N’oublions pas les réserves de riz concassé, les boîtes de sardines, le coulis de tomates, les bidons d’huile ou encore du beurre clarifié. Tout cela conserve très bien.
Vous êtes un cueilleur de champignons averti ? Desséchez donc votre récolte de cèpes, girolles et chanterelles au dessiccateur – en vente dans tous les magasins bio. Ils prendront très peu de place. Prévoyez aussi suffisamment de farine bio pour faire votre propre pain. Mais attention à la vermine ! Pensons même – pourquoi pas ? – au dessert : bocaux de cerises, pêches et poires au sirop, confitures, miel, café soluble et lait concentré sucré, lait en poudre pour le bébé, tablettes de chocolat, bouteilles de sirop, bière maison – kit de fermentation – et vins de fruit… Pour les coups vraiment durs, une caisse de produits lyophilisés viendra compléter l’épicerie domestique. Ils sont plus chers mais se conservent presque indéfiniment – une vingtaine d’années. Tant que j’y pense, n’oubliez pas les croquettes du p’tit chat !
Conservés en cellier, les aliments suivants se conservent moins longtemps mais permettent néanmoins de passer l’hiver : courges du jardin, tresses d’oignons et d’échalotes suspendues, caisses de patates douces, pommes de terre associées astucieusement aux pommes de longue conservation – ‘Gris Braibant’, ‘Godivert’, ‘Reinette Hernaut’, ‘Président H. Van Dievoet’… -, variétés de poires d’hiver – ‘Jules d’Airoles’, ‘Comtesse de Paris’, ‘Beurré de Naghin’… – alignées sur claies, bacs de châtaignes et de noix du jardin. Réserver l’endroit à température la plus stable – 10 à 12°C – pour les fromages durs de longue conservation : tome de Savoie, roquefort, beaufort…
Dans la partie totalement obscure, on peut encore placer des bacs pour le forçage des racines de chicons, afin de bénéficier d’une sorte de potager d’hiver. Ne perdons pas de vue les légumes qui ne nécessitent aucun moyen de conservation car ils passent l’hiver dehors : les poireaux, les choux et les topinambours. Quant aux œufs frais, ils peuvent se récolter quasi toute l’année au poulailler. Point besoin d’ajouter qu’en période de vaches maigres, mieux vaut vivre à la campagne et s’adonner aux joies de la permaculture bio, plutôt que de céder aux hypothétiques facilités de la ville…
Et les biens non-alimentaires ?
Nous n’imaginons plus assez à quel point notre société dépend des sources d’énergie, et de l’électricité en particulier. Une panne généralisée… et le chauffage ne démarre plus ! Du coup, il n’y a plus d’eau chaude non plus. Zut, le PC est à l’arrêt et la machine à café reste muette. Mais là n’est pas le plus grave : le distributeur de billets ne fonctionne plus non plus – pensez donc à avoir, chez vous, une petite réserve de cash ! -, tout comme la pompe à essence. Inutile de préciser que tout le monde est plongé dans l’obscurité car personne évidemment n’a songé à stocker des bougies. Alors on fait quoi ?
En cuisine, à défaut de plaques chauffantes, il faudra probablement se rabattre sur le réchaud de camping. Pensez donc aussi aux stocks… de boîtes d’allumettes, vous allez en avoir besoin. Parmi les ustensiles de secours qui doivent figurer dans le « kit de survie familial », il y a aussi la radio. Elle sera solaire-dynamo. La radio reste, en effet, le principal dispositif qui permet de se tenir au courant lorsqu’une catastrophe majeure survient. Multifonctionnel, le modèle Panther, par exemple, permet non seulement de recharger son téléphone portable grâce à une prise USB mais aussi de s’éclairer grâce à une ampoule LED incorporée. Une minute de manivelle suffit pour écouter les news pendant un quart d’heure. Dans le commerce, on trouve encore d’autres articles conçus spécialement pour les situations de détresse, du banal couteau suisse Victorinox multifonction, au couteau Semptec muni d’un allume-feu au magnésium.
Toujours au « rayon du boy-scout débrouillard », à l’intention de ceux qui sont équipés d’un poêle à bois, on trouve le bois de chauffage dont il faut toujours garder un stock sous la main, de quoi pouvoir se chauffer en hiver, au cas où le chauffage serait inutilisable.
C’est quand le pendule s’arrête qu’on entend son tic-tac…
On ne se rend vraiment compte du luxe que représente l’eau courante… que lorsqu’il n’y en a plus ! En cas de coupure annoncée de l’eau de distribution, pensez donc à remplir tous les grands récipients disponibles, comme la baignoire, les bidons, les seaux… Pour se pourvoir en eau potable, hormis l’eau minérale en bouteille, il existe des gourdes filtrantes LifeStraw ou encore des filtres portables Katadyn Pocket qui s’avèrent parfois très utiles, une fois qu’on est coincé au milieu de nulle part. On les trouve, dans les magasins de camping ou de bushcraft : A.S. Adventure ou Décathlon…
Le manque d’hygiène est à l’origine de nombreuses maladies. S’il devient impossible de se doucher, se laver les mains reste le geste le plus important. Pensez donc à stocker du savon, du dentifrice, une trousse de toilette, quelques flacons de détergent, des sacs poubelle et… les désormais célèbres rouleaux de papier hygiénique ! Last but not least, il est également bon de garder à portée de main une trousse de premiers soins. Doivent y figurer, les médicaments personnels prescrits par votre médecin, des analgésiques, des remèdes contre la diarrhée, les refroidissements, les vomissements, un désinfectant pour les plaies, des compresses, des pansements, une pince à épiler, un thermomètre, une paire de ciseaux, etc.
Les stocks disponibles en pharmacie sont souvent très limités. Aussi, conserver des antibiotiques peut sauver des vies. Quant aux fameux comprimés d’iodure de potassium, ils sont gratuits et à votre disposition en pharmacie, en cas d’incident nucléaire. Hélas, la pharmacienne de mon village m’a confessé que bien peu d’habitants lui en ont demandés. Heureusement que ce genre d’accident « n’arrive jamais »… Le déni ferait-il donc partie des réflexes de survie d’Homo sapiens ?
—-
Toujours garder les documents importants à portée de main !
Lors des inondations catastrophiques de juillet 2021, beaucoup de sinistrés ont dû quitter leur habitation dans la précipitation, sans même savoir ce qui allait advenir de leurs biens. Miraculeusement indemnes, certains se sont retrouvés court-vêtus sur leur propre toit, sans même être en mesure… de prouver leur identité !
En temps utile, il est donc indispensable de rassembler tous les documents importants et de les conserver dans un endroit sûr ou, mieux encore, dans une mallette étanche, à portée de main. Idéalement, devraient y figurer au moins des copies des documents suivants :
– actes de naissance, mariage, décès… pour chacun des membres de la famille,
– livrets d’épargne, contrats bancaires, actions, titres, polices d’assurance, ainsi que les attestations de rente, de retraite ou de revenus, les derniers avertissements-extraits de rôle du SPF Finances…
– diplômes scolaires, universitaires et autres certificats, contrats de location, de leasing, testaments et autres procurations…
– cartes d’identité, passeports, permis de conduire et papiers du véhicule, ce dernier ayant été, le plus souvent, emporté au loin par la rivière en crue…
– extraits du plan cadastral, preuves de paiement des primes d’assurance, en particulier pour la retraite, preuves d’inscription à l’ONEM, factures prouvant des facilités de paiement, etc.
– et, bien sûr, votre fameux Pass sanitaire ou vaccinal, prouvant votre vaccination à la Covid-19, puisqu’on risque toujours de l’exiger à l’entrée de l’un ou l’autre service d’urgence…
—-
En guise de conclusion (temporaire)
Bon. Pas de panique. Il est très difficile d’imaginer ce qui pourrait engendrer une authentique situation de détresse, et de savoir par conséquent ce qu’il est vraiment utile de faire, dès maintenant, pour bien s’y préparer. Il n’est, bien sûr, jamais inutile d’y avoir un peu songé en temps opportuns, sans sombrer pour autant dans l’anxiété permanente, ce qui serait la pire des choses pour notre santé mentale… Mais quand même. Nous l’avons évoqué : une certaine insouciance ressemble aujourd’hui trop souvent à du déni. Diverses formes de vigilance et de prévoyance citoyennes paraissent même devenues indispensables. Evitons en l’occurrence de nous caricaturer nous-mêmes : bien sûr que les membres de Nature & Progrès sont avertis de ces questions et savent comment cultiver et conserver leurs propres aliments… L’autarcie et le repli sur soi, sachons le reconnaître, seraient sans doute, par conséquent, des tentations bien dangereuses en cas de crises redoutables.
Il y a donc – nous les avons énumérés – de simples préparatifs à effectuer sereinement, de vrais réflexes salutaires qu’il nous faut acquérir sans délais, une capacité nouvelle que nous devons travailler en nous-mêmes afin de réagir efficacement face à des situations qui seront forcément inédites et que nous sommes, le plus souvent, totalement incapables de prévoir. Nos meilleures chances, ne nous y trompons pas – et la tragédie des inondations l’a clairement démontré -, résideront dans nos ressources humaines et morales, en termes de solidarité, d’altruisme et d’entraide. A cela aussi, nous devons nous préparer…
2e partie
« Et si l’or bleu venait à manquer ? »
Comment peut-on encore gaspiller l’eau potable en l’utilisant négligemment aux toilettes ou en remplissant sa piscine, quand partout la terre se craquelle ? Dans une Europe en voie d’assèchement, elle est devenue une ressource rare, forcément de plus en plus chère et… source de conflits…
Quelles pistes devons-nous aujourd’hui adopter pour une gestion responsable, équitable et résiliente de l’eau ? De quoi s’adapter aux effets de plus en plus préoccupants du dérèglement climatique. Ces quelques petits conseils doivent-ils être prodigués aux seuls ménages ? Ou devons-nous aussi prendre en considération l’empreinte hydrique de notre industrie ? Voire celle de notre agriculture intensive, si gourmande en eau ? Voilà ce que se propose d’examiner cette seconde partie de l’étude…
Les deux faces d’une même pièce
Après s’être longuement penché sur la façon de prévenir et de contrer les inondations, voilà que l’actualité de l’été 2022 nous pousse soudain vers l’autre ornière : affronter les sécheresses à répétition ! Eh bien oui, juillet 2021 et juillet 2022 évoquent à eux seuls les effets désastreux du Changement climatique. Inondations record et sécheresse historique ne sont en réalité… que les deux faces d’une seule et même pièce. Dans son 6e rapport daté du 9 août 2021, le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) annonce sans sourciller que le changement climatique est en train de se généraliser, de s’accélérer et de s’intensifier. A l’avenir, les vagues de chaleur seront plus fréquentes, plus longues, plus sévères, surtout en Europe, région où tous ces changements s’exerceront de manière deux fois plus violente qu’ailleurs. Excusez du peu !
Dans le sud de la France, le mois de juillet dernier aura été le plus sec depuis le début des relevés météorologiques. Un phénomène associé à des vagues successives de sécheresse et de pics de chaleur extrêmes, entrainant à leur tour des effets dramatiques sur la végétation forestière, vulnérable au stress hydrique avec risques accrus d’incendie à la clé, parfois incontrôlables, comme en Gironde ou en Dordogne.
En réaction à ce scénario peu réjouissant pour l’avenir de la planète, la rhétorique habituelle exige de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde est maintenant bien d’accord là-dessus, mais il faudra aussi désormais – et c’est le thème de ce dossier – pouvoir s’adapter à tous ces changements. Car ceux-ci sont, hélas, irréversibles. N’en déplaise aux sceptiques, il n’y a pas de retour attendu « à la normale » avant… quelques milliers d’années !
« Iceberg droit devant capitaine ! »
A vrai dire, les climatologues – traités jusqu’ici au mieux de grincheux ou de catastrophistes – ne s’attendaient pas à un tel coup d’accélérateur. Ils sont aujourd’hui dépassés par l’ampleur des événements. L’horizon 2030-2040 ? Il est pulvérisé ! L’augmentation du nombre de périodes de sécheresse, tant en fréquence qu’en intensité rend la question de l’eau de plus en plus préoccupante, avec – on s’en doute – des effets catastrophiques sur notre approvisionnement, sur l’ensemble des écosystèmes, sur notre agriculture et notre alimentation en particulier.
La situation est même à ce point alarmante, qu’à la COP 27 qui s’est tenue en Egypte, l’ONU nous demande de nous préparer… aux vagues de chaleur. Sympa ! Depuis l’accord de Paris, l’espoir de limiter le réchauffement climatique à +1,5°C est, en effet, largement dépassé et considéré comme « hors d’atteinte ». Nous courons droit vers les +2,8°C. Un brin désabusé, Antonio Guterres, Secrétaire Général de l’Organisation, en tribun désappointé de la lutte contre la crise climatique, ne mâche pas ses mots : « Nous nous dirigeons droit vers une catastrophe mondiale », affirme-t-il sans détours. Beaucoup de régions de la planète, touchées par les méga-sécheresses occasionnelles, risquent de devenir des zones définitivement sèches… Et donc tout simplement invivables pour l’être humain (6).
Cet été, les Européens ont tiré la langue en affrontant le manque d’eau potable. Rien qu’en France, nonante-trois départements sur nonante-six ont connu des restrictions dans l’usage de l’eau dont soixante-six concernant l’eau potable. Tous les prélèvements non-prioritaires y ont été interdits : arrosages de jardins, d’espaces verts, de terrains de golf, lavage des voitures et bien sûr le remplissage des piscines… Des restrictions d’eau qui, pour l’heure, sont toujours en cours dans certaines régions.
« Quand tu portes ton propre seau d’eau, tu te rends compte de la valeur de chaque goutte… »
Et en Belgique ? Faute d’eau potable au robinet, de nombreuses communes wallonnes n’ont eu d’autre alternative que d’être approvisionnées par camions-citernes de soixante mille litres chacun. Cet automne encore, en Ardenne, ils font la navette depuis le barrage de Nisramont pour pallier au manque d’eau dans certaines zones de captage. Du jamais vu ! Un surcoût environnemental dont on se serait évidemment bien passé… Les sources seraient-elles moins bien approvisionnées que par le passé en raison d’un déficit pluviométrique ? Ou peut-être, au fil du temps, les besoins de consommation sont-ils devenus de plus en plus importants ? Les deux assurément. Selon la fédération professionnelle des opérateurs d’eau, un ménage moyen de trois personnes ne consommerait que cent quatre mètres cubes d’eau potable par an, un chiffre qui serait même revu à la baisse, ces dernières années en raison notamment de la performance des appareils économes en eau. Bonne nouvelle donc ? Pas sûr…
Car, à notre petite consommation, s’ajoutent d’abord les pertes liées au vieillissement de notre réseau de distribution – jusqu’à 20% ! La « Stratégie Intégrale Sécheresse », S.I.S., lancée à l’initiative de la ministre Céline Tellier, approuvée par le gouvernement wallon en juillet dernier, a notamment retenu, parmi ses nombreuses mesures, d’améliorer la performance du réseau d’eau potable en réduisant les fuites. Avec nos quarante mille kilomètres de réseau – de quoi faire le tour du globe – il y a encore du pain sur la planche !
Pour être tout-à-fait honnête, il faudrait cependant préciser que nos besoins en eau ne se limitent pas à l’écoulement du robinet de la cuisine et à celui de la salle de bain. Selon l’ONG Water FootPrint Network (7), l’empreinte hydrique du Belge serait quand même une des plus importante au monde… si on veut bien tenir compte de nos consommations indirectes, incluant ne serait-ce que la quantité d’eau nécessaire pour faire pousser les aliments que nous mangeons et celle qu’il faut pour fabriquer les vêtements que nous portons. Les chiffres cités en la matière laissent rêveur. La fabrication d’un hamburger ? Mille litres d’eau ! Celle d’un simple jean ? Dix mille litres… Notre hyperconsommation pèse lourd sur les réserves en eau et, même si la consommation journalière du ménage belge est relativement sobre par rapport à celle des autres Européens, il en consomme malgré tout bien trop. Et il y a fort à parier qu’à l’avenir, restrictions et coupures d’eau se feront de plus en plus pressantes…
« Tirer une chasse d’eau potable sera bientôt une aberration totale, voire une hérésie »
A domicile, les principaux postes de consommation d’eau potable se trouvent aux toilettes – 31% – et à la salle de bain – 36%. Se rajoutent à cela, la consommation pour la lessive – 12% -, l’entretien – 9% – et la vaisselle – 7%. En comparaison, l’utilisation en cuisine pour l’alimentation et les boissons apparaît, somme toute, presque négligeable – 5%. De tels pourcentages laissent entrevoir l’énorme potentiel que représente, par exemple, la récupération systématique de l’eau de pluie. Au moins 60% de notre consommation domestique – salle de bain + toilettes – pourrait ainsi être facilement satisfaite, sans compter les usages en extérieur… Mais on mesure surtout pourquoi laver chaque semaine sa voiture, sa terrasse ou son trottoir, arroser copieusement ses vertes pelouses avec de l’eau potable sont devenus des gestes peu éco-responsables, de plus en plus mal vus par l’entourage, surtout quand les pluviomètres restent désespérément vides.
Au nord du pays, comme chez nos voisins néerlandais, le problème devient vraiment très préoccupant. D’année en année, en plus d’être fortement exposé aux pollutions agricoles dont sont responsables les élevages intensifs, le niveau des nappes phréatiques baisse dangereusement. Selon le World Resources Institute, la Flandre est de plus en plus exposée au manque chronique d’eau. Au niveau mondial, même la Namibie ferait mieux ! Ceci explique pourquoi la politique menée en Flandre pour valoriser l’eau de pluie est si différente de celle menée jusqu’ici en Wallonie. Elle est même diamétralement opposée !
En Wallonie, l’inquiétante sécheresse de 2022 fut visible surtout au niveau des cours d’eau historiquement bas, où la pratique du kayak et celle de la pêche furent interdites. Mais notre inquiétude n’aura été, en fin de compte, que fort limitée. Les précipitations de l’automne et de l’hiver précédents avaient été suffisamment abondantes pour permettre de recharger les nappes. C’est dans ces réservoirs souterrains naturels, situés essentiellement dans les zones calcaires, qu’est essentiellement prélevée notre eau de distribution – à raison de 79,2%.
Seules quelques dix-huit communes wallonnes, afin d’éviter tout gaspillage, ont été contraintes de prendre des mesures pour restreindre leur consommation d’eau. De leur côté, pour atténuer les effets du réchauffement sur notre approvisionnement, les hydrologues ne manquent pas d’imagination. Parmi les bonnes idées formulées dans la S.I.S., notons la lutte contre l’imperméabilisation et le soutien à l’infiltration des eaux à très grande échelle, en généralisant par exemple la plantation de haies et de bandes boisées. De telles mesures permettent aux eaux pluviales de recharger davantage les nappes phréatiques, plutôt que de s’engouffrer directement dans les caniveaux…
Plutôt que de puiser sans cesse dans les nappes phréatiques, il faudrait peut-être aussi penser à réutiliser les eaux usées. Une fois épurées, elles pourraient très bien servir à l’irrigation des cultures…
En ville, où le moindre mètre carré est asphalté et bétonné, il serait judicieux de créer des trames bleues et vertes en périphérie. Quant aux particuliers, il serait bon de doter chacune de leur habitation d’une grande citerne d’eau de pluie…
« Chacun tire l’eau à son moulin »
Généraliser la récupération de l’eau de pluie est une réponse particulièrement intéressante à développer, d’autant qu’à l’instar des autres mesures énumérées ci-dessus, elle atténue également les pics d’écoulement lors de fortes pluies, surtout en ville. Par effet tampon, cet effort de récupération sera de nature à éviter le débordement des égouts et celui des stations d’épuration, tout en diminuant indirectement les risques de débordement des rivières. Les deux phénomènes, sécheresses et inondations, sont ainsi définitivement liés.
Hormis sa précieuse gratuité, ce don de la nature qu’est l’eau pluviale présente encore de nombreux autres avantages d’un simple point de vue domestique. Exempte de calcaire, elle prolonge notamment le fonctionnement des appareils ménagers : machines à laver, machines à café, bouilloires, conduites d’eau, robinetterie et pommeaux de douche… Très douce, l’eau de pluie est idéale aussi bien pour laver le linge que la vaisselle. Plus besoin par conséquent d’adoucisseur, de produits anticalcaires ou de détartrage, sans compter l’économie substantielle en savons divers et détergents non ou peu biodégradables.
« Et contrairement à ce qu’on peut lire sur les fiches pratiques publiées par Aquawal, relève Eric Simons, de la société Airwatec, spécialisée en filtration et traitement des eaux, l’eau de pluie n’est pas mauvaise pour la peau. Tant qu’elle n’a pas atteint le sol, celle-ci est de très très bonne qualité. » On a longtemps jeté systématiquement le discrédit sur l’eau de pluie – tiens, tiens, ce qui est gratuit serait-il forcément moins bon? – mais une fois filtrée, sa qualité est vraiment remarquable : pas de chlore, pas de nitrates, pas de résidus de pesticides…
« En revanche, de plus en plus de produits chimiques se retrouvent dans les nappes phréatiques dont la qualité n’arrête pas de se détériorer. La situation n’est plus la même que dans les années soixante et évolue sans cesse, souligne encore Eric Simons, aujourd’hui des traces d’antibiotiques et de perturbateurs endocriniens par exemple s’y retrouvent. Or, il n’existe aucune méthode, aucune membrane d’osmose pour s’en débarrasser ! »
En France, d’après le journal Le Monde, des substances issues de la dégradation des pesticides épandus durant des décennies sur les terres agricoles, ont fini par percoler jusque dans les nappes phréatiques. Ces produits – parfois entre-temps interdits à la vente et/ou à l’usage – se sont fragmentés et recombinés en nouvelles molécules, connues désormais sous le nom de métabolites. On estime à présent, que douze millions de personnes auraient au moins épisodiquement consommé une eau « non conforme », polluée par ces substances aux noms barbares. Parmi elles, le chloridazone desphényl dérivé d’un herbicide utilisé dans la culture de betteraves. Avec des concentrations maximales régulièrement dépassées, le principe de précaution aurait dû être appliqué. Un prochain scandale sanitaire en suspens ? Voilà qui en dit long en tout cas sur l’étendue de la contamination de nos ressources en eau par les pesticides mais aussi sur les lacunes dans la surveillance de la qualité de l’eau potable – jusqu’ici, la plupart de ces substances dont la toxicité reste inconnue ne sont tout simplement pas recherchées -, sans parler du désarroi de nos élus et des autorités sanitaires contraints d’imaginer, en urgence, de nouvelles normes moins restrictives pour éviter de devoir interdire la consommation d’eau de distribution dans certaines régions…
Aujourd’hui, pour des raisons écologiques mais pas seulement, un nombre croissant de consommateurs se tournent vers l’eau de pluie et optent pour le placement d’une citerne afin de satisfaire au moins une partie de leurs besoins domestiques. Obligatoires en Flandre et à Bruxelles lors de la construction, les nouvelles habitations en sont désormais systématiquement équipées. En Wallonie, il n’a pas semblé nécessaire au législateur de les imposer car de nombreux constructeurs s’en sont équipés spontanément, soit par souci de rentabilité, soit parce que les autorités communales, en particulier celles qui sont régulièrement en déficit hydrique, conditionnent simplement l’installation d’une citerne au permis d’urbanisme, tandis que parfois, d’intéressantes primes sont octroyées…
Reste cependant un problème de taille : si l’eau de distribution est un des produits alimentaires les plus contrôlés – trente mille analyses par an -, par des prélèvements opérés sur les lieux de captage ou directement au robinet du consommateur, en passant par les zones de stockage – d’après la Société Publique de Gestion des Eaux (SPGE), les normes de qualité sont même supérieures aux exigences légales – il n’y a évidemment guère de garanties apportées pour les eaux dites « alternatives », à savoir l’eau de pluie, l’eau de puits et l’eau de source. Chargée de micro-organismes – virus, bactéries – et de différentes matières en suspension lors de son parcours – toit, gouttière, citerne -, l’eau de pluie est impropre à la consommation en tant que telle. Quant aux eaux de puits ou de source, après avoir ruisselé sur les terres agricoles, elles peuvent malheureusement être chargées en nitrates et en résidus de pesticides. Pour des raisons sanitaires évidentes, ces eaux pourraient donc, en principe, n’être destinées que pour l’usage externe sans risques sanitaires : le jardin, la serre, l’entretien du logement, le lavage de la voiture, à la buanderie ou encore aux toilettes.
« Creusez un puits avant d’avoir soif »
Précisons encore que si les propriétaires de citernes d’eau de pluie ne doivent pas les déclarer, ceux des puits sont soumis à d’autres obligations : couvercles fermés à clef, compteurs volumétriques, taxes pour le rejet d’eaux usées, etc. Quant au forage, la tâche doit être exécutée par un professionnel agréé et, cette fois, c’est le permis d’environnement qui est requis. Dans tous ces cas de figure, afin d’éviter toute contamination du réseau publique d’eau potable par une eau qui ne le serait pas, Aquawal a tout prévu. À l’intérieur de l’habitation, c’est le « Code de l’eau » qui s’applique, en reprenant les règles à respecter. Toute connexion physique entre le réseau de distribution et autre « réseau alternatif » est interdite, notamment par un jeu de vannes ou de clapets anti-retour. Ces réseaux doivent donc faire l’objet de raccordements distincts.
Comme la potabilité de l’eau recueillie à la sortie des gouttières peut être mise en doute, le particulier se voit généralement contraint a priori de ne valoriser son eau de pluie qu’à la buanderie, au garage ou au jardin. Même limité uniquement à l’usage des toilettes – ce qui représente quand même un tiers de la consommation d’un ménage – l’utilisation de l’eau de pluie représente déjà une jolie économie. Fort heureusement, il existe des dispositifs compacts et relativement bon marché pour traiter l’eau, ce qui permet d’élargir davantage le champ des applications, le tout avec une sécurité accrue d’utilisation. Le kit Cintropur TRIO-UV triple action – filtration des particules, traitement par charbon actif et stérilisation UV – que nous avons testé, assure par exemple un traitement intégral particulièrement intéressant.
Extraite de la citerne par une aspiration flottante, le traitement de l’eau se fait, dans un premier temps, par filtration mécanique à l’aide d’une « chaussette » – un tamis de 25μ -, afin de retenir les particules les plus fines. L’eau est ensuite traitée au charbon actif à base de noix de coco, puis est finalement stérilisée par rayonnement UV. L’eau de pluie peut alors être valorisée à hauteur de 95%, et être utilisée en toute sécurité, pour toutes les applications sanitaires de la maison : lave-vaisselle, lave-linge – sept mètres cubes par an -, bains, douches, lavabos, jacuzzis… Et même la piscine – soixante mètres cubes ! – Ces piscines dont les ventes ont littéralement explosé avec la succession d’étés caniculaires. Le serpent est en train de se mordre la queue !
Contrairement aux processus chimiques de désinfection par l’ajout de chlore, la stérilisation par rayonnement UV est un moyen physique germicide, sans risque de surdosage et sans sous-produits toxiques. Durant le passage de l’eau, les bactéries, les virus et les protozoaires sont neutralisés. L’eau de récupération débarrassée de son goût et de ses odeurs désagréables de citerne devient pure bactériologiquement. Notons cependant que cette eau n’est toujours pas considérée comme 100% potable tant que les paramètres chimiques n’auront pas, eux aussi, été vérifiés et jugés satisfaisants. Ainsi, écologie rime-t-elle aussi avec économie pour le budget du ménage. Mais ceux qui n’ont pas envie de se lancer dans une telle entreprise, peuvent déjà commencer par une utilisation minimale de l’eau de pluie au jardin, le plus simple consistant, par exemple, à raccorder, sur la terrasse, une descente de gouttière à une cuve ou à un tonneau, via un collecteur à filtre WISY qui envoie à l’égout feuilles, mousses et invertébrés indésirables. L’appoint en eau propre est tout sauf négligeable. Les récipients de mille, voire deux mille litres, sont peu onéreux et aisément disponibles en jardineries…
Des citernes et des primes : nos meilleurs « tuyaux »…
Pour ce qui est du stockage, il existe plusieurs types de citernes. Les modèles aériens en polyéthylène, imputrescibles et résistants au gel, montent jusqu’à dix mille litres. Certains peuvent aussi être enterrés et même jumelés. Hélas, ces derniers sont assez onéreux : trois mille cinq cents euros pièce, hors travaux de terrassement…
La formule idéale semble plutôt être la dépose dans le sol, lors de travaux de construction ou de restauration, de citernes en béton de dix mille voire vingt mille litres… Budget : deux mille cinq cents euros, hors terrassement. L’investissement est donc relativement vite amorti. Avec les citernes en béton, l’acidité de l’eau stockée est en plus rapidement neutralisée. Notons aussi que la plupart des gens qui recourent à l’eau de pluie regrettent généralement de ne pas avoir opté, dès le départ, pour une citerne de plus grande capacité…
Pour récupérer l’eau de pluie, mieux vaut encore que le toit soit pentu et recouvert de tuiles car la superficie de captage est plus grande. Les toits plats couverts de membranes collées à chaud, ne sont pas adaptés à la récupération de l’eau de pluie ; ils exhalent une odeur de goudron. En période de canicule, les algues ont tendance aussi à y proliférer et à boucher les filtres. En Wallonie, la pluviosité est variable d’une région à l’autre, mais la moyenne est d’environ huit cent cinquante millimètres par an, soit huit cent cinquante litres par mètre carré. Pour récupérer entre quarante-cinq et nonante mètres cubes par an, la superficie totale du toit devrait idéalement être comprise entre cinquante et cent mètres carrés en projection horizontale.
Aujourd’hui, tous les nouveaux raccordements à l’eau de distribution entrainent obligatoirement la visite d’un certificateur agréé pour l’obtention du CertIBEau. Ce certificat garantit la conformité des installations au « Code de l’eau » : sécurité sanitaire des installations intérieures en eau potable et préservation de l’environnement pour les rejets d’eaux usées.
Le prix approximatif d’une pompe auto-amorçante WILO, de type MC305, pour récupération de l’eau de pluie est de 640,- euros, celui d’un kit de filtration Cintropur TRIO UV est de 720,-€. Le prix moyen TVA incluse de l’eau de distribution incluant le « Coût Vérité de la Distribution » (CVD) et le « Coût Vérité de l’Assainissement » (CVA) avoisine actuellement les six euros le mètre cube ; il avait doublé entre 2004 et 2014, mais voilà qu’après une période de stabilisation, celui-ci repart de nouveau à la hausse…
En Région bruxelloise, il existe des primes à l’installation de citernes d’eau de pluie. De cent à… mille sept cents euros, à Saint-Josse notamment, selon certaines conditions liées en particulier aux revenus des intéressés.
Côté Région wallonne, pas de primes à attendre… sauf dans certaines communes. Pour leur installation ou leur rénovation, les communes de Burdinne, Donceel, Remicourt, Stoumont, Thimister et Wasseiges, Namur, Somme-Leuze, Rochefort, Braine l’Alleud, Plombières, Fauvillers, Libramont et Vielsalm, remboursent jusqu’à cinq cents euros. C’est toujours bon à savoir !
Agriculture : à quand la Transition durable ?
Alors que partout les besoins en eau explosent, l’ONU estime que mondialement, ils devraient encore augmenter de 90% d’ici 2050 – par rapport à 2017. Le déficit menace désormais un quart de la population mondiale, régulièrement sujette à un stress hydrique extrême. Parmi les différentes grosses consommations d’eau, on trouve bien sûr les besoins directs liés à la consommation domestique, notamment dans les grandes villes – 8% -, elles-mêmes étroitement tributaires de la croissance démographique : nous sommes, depuis mi-novembre, huit milliards d’êtres humains. Mais il y a aussi les besoins indirects comme ceux liés à l’industrie – 22% -, ainsi que le secteur de la production d’énergie, son corollaire. Pourtant c’est surtout le secteur agricole qui doit retenir nos préoccupations. Dans le monde, 70% de la consommation d’eau est destinée à l’irrigation des cultures.
Comment adapter durablement cette énorme consommation aux conséquences des grands bouleversements climatiques qui s’annoncent, tout en répondant efficacement à des besoins alimentaires planétaires toujours en croissance ? De nombreux éléments de réponse sont déjà bien connus. Aussi ne ferons-nous ici que les ébaucher. Dans les pays émergents, ce sont désormais les nouveaux modes de consommation alimentaire qui se taillent la part du lion. Les populations, autrefois peu développées, mangent de nos jours davantage de viandes et de laitages. Or pour produire un seul kilo de viande de bœuf, il faut… quinze mille cinq cents litres d’eau ! Un régime alimentaire clairement intenable s’il fallait l’étendre à huit milliards d’habitants.
Chez nous, la fabrication de biocarburants cristallise, à elle seule, toute l’absurdité de notre société de consommation : la fabrication d’une tonne équivalent pétrole – 1tep – d’éthanol à partir de maïs nécessite… un quart de million de litres d’eau ! La même tep de biodiesel à partir de soya nécessite cent soixante mille litres. C’est donc bien notre mode de vie gourmand en ressources et notre hyperconsommation compulsive qui – a fortiori si elles sont exportées dans le sud – pèsent le plus sur les réserves d’eau de la planète.
Calamités agricoles
Depuis quelques années déjà, nos cultures se heurtent à l’irrégularité et à l’imprévisibilité des précipitations, tandis que les périodes de sécheresse ne cessent de se prolonger. Entre le moment où les agriculteurs ont besoin d’eau et le moment où elle tombe du ciel, le décalage peut être fatal aux cultures. Et comme il fait de plus en plus chaud, irriguer les cultures demande davantage d’eau dont une partie toujours plus importante s’évapore. Il ne s’agit plus de simples caprices de la météo, mais bien de transformations profondes d’un climat qui déstabilisent structurellement les pratiques : « l’avenir n’est plus écrit par le passé ». Sont évidemment montrées du doigt, les cultures très gourmandes en eau, comme les immenses champs de maïs, qui sont aussi les plus fragiles. Avec toutes les conséquences que cela implique principalement sur l’élevage…
En France, des manifestations, parfois violentes, voient le jour : depuis les sécheresses, l’accaparement de l’eau devient une source majeure de conflits. Certains parlent carrément de « guerre de l’eau ». Les méga-bassines, installées par des agriculteurs, – dans les Deux-Sèvres notamment – au mépris des réalités hydrologiques, sont prises à partie, les opposants invoquant la confiscation, au seul profit de quelques-uns, d’une ressource vitale, d’un bien commun. Désormais, les conflits qui concernaient seulement les cultures, touchent aussi les terrains de golf, les terrains de foot, les piscines, les jacuzzis, les pelouses, les parcs publics…
Une précieuse ressource qui subit de plein fouet le changement climatique !
Une première conclusion semble s’imposer afin d’anticiper des conflits qui risquent de dégénérer rapidement : il est indispensable de réduire nos consommations et de mettre en place une gestion équitable de cette ressource fragile et limitée qu’est l’eau. Mais comment faire ? Voici quelques pistes souvent évoquées ; nous laisserons, quant à nous, le soin aux gens de terrain de les investiguer plus en profondeur et d’en débattre sereinement :
– augmenter l’offre par davantage de pompages souterrains et de déviations de rivières ? Irriguer davantage, alors que le thermomètre s’affole, ne saurait résoudre toutes les difficultés auxquelles est confrontée l’agriculture. Les risques d’évaporation et d’assèchement, de dérèglement de systèmes hydriques complexes compenseront sans doute bien mal notre manque de résilience agricole face aux extrêmes climatiques…
– modifier nos consommations en limitant, par exemple, drastiquement les produits de l’élevage ;
– modifier les périodes de semis et de récoltes afin de mieux adapter les choix de cultures à l’évolution générale du climat et singulièrement des températures saisonnières…
– introduire de nouvelles cultures mieux adaptées au dessèchement des sols. Le sorgho serait-il apte, par exemple, à remplacer les cultures de maïs pour l’alimentation animale ?
– tabler davantage sur les enseignements de l’agroécologie, en introduisant davantage de biodiversité au sein de nos cultures afin de mieux lutter contre les maladies et les ravageurs ?
– pratiquer des semis sur sols non labourés et opter résolument pour un couvert végétal permanent afin de limiter le ruissellement des eaux, au moment de la saison sèche ?
Le débat a commencé, l’urgence est là…
Conclusion
Par Dominique Parizel
Notre quête de résilience, individuelle et collective, dépend avant tout de la conscience que nous avons de l’état du monde, tel que nous sommes en mesure de le percevoir. Cet état de conscience est éminemment dépendant des circonstances particulières que vit chacun d’entre nous, constamment altéré par les nécessités prioritaires du quotidien. Nous voyons en quoi notre faculté à concevoir la résilience s’inscrit irrémédiablement dans un insupportable monopoly d’inégalités, comment elle est sans arrêt en butte aux privilèges et aux conservatismes de toutes natures, aux combats d’arrière-garde les plus vains et les plus insensés, aux certitudes et aux incertitudes du monde scientifique… Pour ces différentes raisons, toute forme de résilience ne peut sans doute se construire que dans la formulation et la confrontation d’idées et d’expériences. Elle est l’imagination, la créativité du désespoir. Mais nous ne pouvons rien sans elle… Cet enjeu fondamentalement sociétal qui n’est, dans un terme incertain, rien d’autre que les conditions mêmes de la prolongation – ou pas ! – de nos vies inscrit d’évidence ces discussions, ces échanges dans le champ d’une citoyenneté active, dans le champ de l’éducation permanente. Car sa démarche, au fond, n’est intrinsèquement qu’inquiétudes et controverses de chaque instant, individuelles et collectives, sur un sujet absolument fondamental, un sujet total : « comment survivre ? » On perçoit, dès lors, beaucoup mieux à quel point cette hantise de l’urgence dépasse er résume toutes les autres préoccupations, et pourquoi il est urgent de la débarrasser de ses superfluités et de ses oripeaux, de rendre son bénéfice accessible à tous ceux et toutes celles qui ont absolument besoin d’entrer dans la chaleur réconfortante de son giron…
Ceux-là, ce ne sont pas nous qui pensons ! Car prendre le temps de penser la résilience est déjà un luxe de riches, d’instruits, peut-être même d’oisifs. Dans quelle tour d’ivoire sommes-nous donc encore confinés pour trouver seulement le loisir d’y réfléchir ? D’autres crèvent, à nos portes, de froid et de misère. D’autres périssent en Manche ou en Méditerranée. D’autres bouffent les pesticides que nous exportons sur le champ où ils triment … D’autres jouent au foot dans l’airco du Qatar, d’autres lancent leur Tesla vers un avenir radieux… D’autres meurent encore pour la grandeur d’un empire… Notre destin dépend surtout de la complexité du monde !
Des épisodes récents, et très malheureux, ont démontré, dans la population, un incontestable potentiel de solidarité. Mais quelles sont ses limites ? De tels élans seraient-ils éventuellement organisables par la puissance publique ou sera-t-il toujours préférable, au contraire, que celle-ci évite de s’en mêler, s’auto-limitant à une fonction très générale de protection des populations et d’aide aux personnes en détresse ? Cette solidarité généreuse et spontanée, qui naît parmi les citoyens en problèmes, ne risque-t-elle pas d’être, le cas échéant, l’alibi le plus détestable que trouveraient les états pour en faire de moins en moins, et laisser la porte ouverte à des acteurs privés qui n’hésiteraient pas à tirer profit du malheur ?
Les élans de solidarité, les dons de soi les plus désintéressés, sont-ils de l’ordre du prévisible ? Témoignent-ils d’une réelle capacité collective de résilience déjà tapie au plus profond de nos âmes ? Participent-ils de réflexes communautaires face à l’insupportable, voire de réflexes de l’espèce lorsque sa sauvegarde est en jeu ? Comment cultiver, au plus profond de nous, individuellement et collectivement, ce qui ressemble néanmoins à une incoercible bonté ? Autant de questions qui ne peuvent sans doute guère s’offrir à la réflexion de nos concitoyens que dans un cadre d’éducation permanente… Car qui serons-nous dans l’épreuve ? Préférerons-nous la lâcheté à la fraternité ? Serons-nous prêts à donner un seul bol de soupe ?
Notes :
(1) Pour ceux qui les auraient déjà oubliés : Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer, petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes, éditions du Seuil, 2015.
(2) « Katastrophen Alarm, Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen », Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
(3) Pour détendre un peu l’atmosphère : fine allusion, que les « moins de vingt ans » ne peuvent pas relever, au tube eighties de Jean-Pierre François qui passerait, de nos jours, pour une provocation post-Covid et provax : https://www.youtube.com/watch?v=oG2FM3Hzz1U…
(4) Bon, d’accord, entrée en fraude par quelque vilain terroriste, les Rambo de service préférant de loin leurs fusils d’assaut M16…
(5) Branchez-vous, par exemple, sur l’ »Académie de la fermentation » : https://academiefermentation.com. Marie Senterre donne également des cours, en ligne ou en présentiel. Contact : marie@academiefermentation.com
(6) Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Nature Reviews Earth & Environment.
(7) Water Footprint Network : www.waterfootprint.org/en/